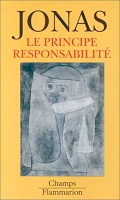 Pour conclure notre première analyse concernant l’interprétation finaliste de la biologie par Hans Jonas, nous abordons maintenant plus en détail la conception moniste de la vie qui en découle. Il s’agira de voir en quoi cette conception permet d’attribuer à l’homme un statut unique dans la diversité de l’évolution, tout en maintenant cependant une continuité avec le reste du vivant.
Pour conclure notre première analyse concernant l’interprétation finaliste de la biologie par Hans Jonas, nous abordons maintenant plus en détail la conception moniste de la vie qui en découle. Il s’agira de voir en quoi cette conception permet d’attribuer à l’homme un statut unique dans la diversité de l’évolution, tout en maintenant cependant une continuité avec le reste du vivant.
Nous avons vu auparavant que concevoir la conscience comme le propre de l’homme est un tour de force que réussit Descartes (nous en avons vu le prix). Contre cette prémisse des sciences de la nature, Jonas défend, en s’appuyant sur Darwin, une continuité entre l’homme et les autres êtres vivants. Cette continuité se traduit par des degrés de conscience, à l’instar de Leibniz, et par l’élargissement du règne de la finalité. Sa conception de la vie est donc moniste, dans le sens où, grâce au concept de continuité, elle est conçue comme un tout qui ne comprend pas de saut ou de rupture mais est au contraire marqué par l’unité, y compris celle de la conscience et de la nature.
Mais cela ne revient-il pas à rabaisser l’humanité ? Ne sommes-nous pas les seuls êtres à véritablement pouvoir être compris selon la téléologie ? Etendre la présence de fins au-delà de l’humanité, si cela revalorise les autres êtres vivants, et, derrière, la nature, peut avant tout être perçu comme un rabaissement de l’homme. Cela ne revient-il pas, en effet, à revoir à la baisse la valeur unique (en tant qu’elle seule est capable de connaissance, de sensibilité et de responsabilité) de la conscience humaine?
Le doute croit, surtout lorsque Jonas défend que la conscience est un moyen pour l’homme d’assurer sa survie. L’une des fins que poursuit l’organisme est la vie elle-même. Jacques Monod et François Jacob défendent que la fin d’un organisme est sa reproduction, sa descendance et donc, en dernière instance, la reproduction de l’espèce.
Dans La logique du vivant, Jacob nous rappelle que si, aujourd’hui, nous vivons, s’il y a des êtres vivants, ce n’est que « dans la mesure ou d’autres êtres vivants se sont reproduits avec acharnement depuis deux milliards d’années ou plus. » (op. cit., pp.12-13.). C’est presque tautologique. La vie est en effet synonyme de reproduction. Et cette reproduction consiste en la perpétuation de l’espèce, à travers la transmission d’un code génétique qui s’est transformé, peu à peu, au cours de l’évolution. De cette manière, « l’être vivant représente bien l’exécution d’un dessein, mais qu’aucune intelligence n’a conçu. Ce but, c’est de préparer un programme identique pour la génération suivante. C’est de se reproduire. » (idem, p.10.).

Jacques Monod
Monod a à-peu-près la même conception du vivant que Jacob. Il propose « arbitrairement de définir le projet téléonomique essentiel comme consistant dans la transmission d’une génération à l’autre, du contenu d’invariance caractéristique de l’espèce. » (Le hasard et la nécessité, op. cit., p. 30.) : les êtres sont organisés de manière à transmettre le code génétique, qui leur est propre et qui varie selon les espèces, à leurs descendants ; le vivant a pour but, pour projet essentiel sa descendance, ce qui est réalisé par la transmission et la reproduction d’un code génétique. Le jeu, par exemple, est alors conçu comme ayant avant tout pour but, surtout chez les mammifères supérieurs, la cohésion du groupe et donc l’expansion de l’espèce grâce à l’avantage pour la survie que confère cette plus grande cohésion. Le jeu est ainsi téléonomiquement orienté vers la survie de l’espèce.
La transmission d’un programme génétique est la définition la plus générale que nous pouvons donner du vivant. Nous pouvons d’ailleurs ici souligner l’importance de la génétique pour la conception du vivant. Darwin, par sa théorie de l’évolution, nous a appris que l’homme est dans la même lignée que les autres organismes : l’homme est apparenté au vivant dans sa totalité. La parenté est d’autant plus accentuée par la biologie moléculaire. En effet, grâce à celle-ci, nous savons désormais que nous partageons l’ADN avec tous les autres membres de la biosphère. Le code génétique que chaque espèce possède provient d’un code génétique originel, sans doute très sommaire, et qui, par de multiples reproductions, s’est modifié, complexifié, faisant alors émerger la diversité biologique que nous connaissons aujourd’hui. En un sens, l’homme et les autres vivants sont frères de gènes. Seule la façon d’utiliser les matériaux varie, mais les matériaux en eux-mêmes sont identiques pour tous les vivants.
Nous avons donc vu que le vivant peut être vu comme un projet téléonomique, dont la fin objective est la reproduction. Mais pour se reproduire, le vivant doit d’abord survivre. Avant d’assurer sa descendance, un organisme doit vivre au moins jusqu’à un âge lui permettant de se reproduire. Avant la reproduction, la vie est donc elle-même l’un des buts que poursuit tout être vivant, que ce soit consciemment ou inconsciemment, l’homme y compris. Cette survie est une lutte. La vie n’est jamais donnée. En effet, contrairement à l’inorganique, l’organique doit sans cesse s’affirmer. Dans un remarquable essai intitulé Le fardeau et la grâce d’être mortel, Jonas s’interroge sur la fragilité intrinsèque de la vie. Faisant une investigation ontologique du vivant, il se demande ce qu’est la manière d’être d’un organisme. Il définit alors l’organisme comme ce qui agit pour continuer à être un organisme. Cet agir dépend de l’environnement et de l’organisme : c’est le métabolisme. La vie est un échange de matière entre l’organisme et son milieu : pour la respiration, pour la nutrition… etc. Cette activité est d’ailleurs ce qui le différencie de la simple matière, qui elle subsiste en étant là, sans effort : « sa conservation est un simple demeurer, non une affirmation de l’être d’instant en instant. » (Hans JONAS, « Le fardeau et la grâce d’être mortel », in G. HOTTOIS (Ed.), Aux fondements d’une éthique contemporaine, H. Jonas et H. T. Engelhardt, Paris, Vrin, 1993, p.41.).
De plus, un objet inorganique est relativement stable, immuable. De lui-même, il ne tend pas au changement : sa matière reste identique. Le vivant, au contraire, n’est jamais composé de la même matière. Toujours identique à lui-même, il change pourtant incessamment de matière par ses échanges répétés avec l’environnement. Le vivant est donc de la matière, mais il ne s’identifie jamais à un état donné de matière. C’est d’ailleurs dans ce curieux phénomène d’identité toujours fuyante que Jonas voit les prémices de ce qui, chez l’homme, s’appelle la liberté. Elle n’est ici qu’une certaine indépendance de l’organisme vis-à-vis de la matière qui le compose, et à laquelle pourtant il n’est jamais réductible. Mais si, en ce sens, le vivant dispose d’une certaine liberté par rapport à la matière, il en est cependant tributaire pour assurer sa survie. « Par conséquent, l’exercice de la liberté dont jouit le vivant est plutôt une dure nécessité. ».
Cette nécessité est celle de la continuelle affirmation de la vie par l’organisme. Tout vivant doit s’efforcer de vivre. Il a besoin, pour continuer à être, d’assurer son métabolisme. Nous voyons ici apparaître le souci qui caractérise toute vie. Tout vivant est dans un état de besoin. Sa vie est sans cesse remise en cause dans les échanges physico-chimiques avec l’environnement. « Le besoin est donc avec elle depuis le début et transforme l’existence acquise de cette manière en un suspend entre l’être et le non-être. » (idem, p.42.). Cela revient à dire qu’avec la vie, la mort apparaît. C’est la menace du non-être, cette possibilité continuelle de la mort, le « pouvoir mourir » qui représente, aux yeux de Jonas, le fardeau de la mortalité.
L’intuition très forte dont veut rendre compte Jonas peut s’énoncer ainsi : la vie dit oui à elle-même. Dans le fonctionnement même du corps, tout est prévu pour assurer sa perpétuelle reconquête. Par le phénomène de la vie, l’être se prononce en sa faveur contre le non-être. Ce n’est d’ailleurs que sur le fond du non-être que l’être peut s’affirmer, « le défi du « non » active et donne force au « oui » » (idem, p.43.). C’est parce qu’il se positionne contre le néant, contre la mort, que l’être est une affirmation. C’est une négation, dans le sens où la vie s’oppose à la possibilité de la mort. Mais dans cette opposition, se cache une véritable affirmation : la vie. C’est cette possibilité du « non » inhérente à la vie qui met en exergue le « oui » essentiel qui s’exprime à travers tout être vivant. L’éthique de Hans Jonas peut d’ailleurs être perçue comme un « non » adressé à toute négation de l’affirmation de la vie. Son éthique a pour fin de protéger la vie humaine et s’oppose à tout ce qui peut la mettre en jeu. Mais en dernière instance, elle est positive : c’est une véritable affirmation de la vie, c’est un « oui ».
Nous avons vu que la vie, cette affirmation qui doit toujours se renouveler sous peine de disparaître, peut être conçue comme une fin objective de l’organisme. C’est à cet effet que nous possédons certains organes. La sélection naturelle a permis, d’une manière non consciente, la survie des organismes les mieux adaptés. Si l’adaptation d’une espèce au milieu peut être remise en cause par un changement de l’écosystème dans lequel elle évolue, il est cependant clair que seuls les êtres ayant un organisme adapté aux contraintes extérieures ont été conservés et ont pu se reproduire. Le fait de posséder des moyens de défense et d’avoir un mode d’échange adéquat à l’écosystème est ce qui à permis aux organismes de survivre et de se reproduire. Certes, il convient de souligner que l’adaptation peut parfois se retourner contre la survie, notamment lorsque les conditions du milieu de vie sont modifiées, mais les changements qui sont conservés, même s’il y a des exceptions, sont ceux qui permettent la survie. Les modifications, dues aux mutations, à la réplication et aux réassortiments de l’ADN, ont été conservées par la sélection dans un but de survie, même si certains changements n’ont pas d’influence sur la capacité de survivre.
La conscience ne déroge pas à cela. Si la conscience est apparue, c’est parce qu’elle a eu un rôle pour la survie. Il n’est pas besoin d’insister sur l’utilité qu’a eu la conscience pour la survie de l’homme. Il suffit de regarder le peu de moyens dont l’homme est physiquement pourvu pour assurer sa survie. Il est évident que la conscience et son développement sont les conditions essentielles de notre existence. Comme le dit Pascal dans ses Pensées, « L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant. ».
La conscience ainsi comprise n’est alors qu’un moyen pour l’homme d’assurer une fin objectivement présente dans la nature, à savoir permettre sa survie. Par nature, l’homme est démuni, mais par sa faculté d’être conscient, il peut suppléer à ses insuffisances constitutives. L’apparition de la conscience n’est alors qu’un des outils qu’a la vie pour s’affirmer. En outre, cette conscience n’est pas apparue d’un seul coup. Elle résulte d’une longue évolution qui a commencé avant l’homme et se retrouve chez d’autres êtres vivants, très certainement un petit nombre, et à des degrés bien moindres, cela va sans dire. Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas obligés de souscrire au dualisme et pouvons rationnellement penser que la dimension intérieure n’est pas le propre de l’homme et doit être présente, de façon restreinte, chez certains animaux pour lesquels elle entre alors en jeu pour une part dans l’agir. La conscience comprise comme une plus ou moins grande intériorité assure alors, chez l’homme mais également chez certains animaux, le rôle d’un moyen supplémentaire pour assurer la survie.
Mais le philosophe ne peut bien évidemment pas se satisfaire d’une définition aussi pauvre, bien que pertinente, de l’esprit. Si la conscience a bien permis notre perpétuation depuis des millénaires, elle ne se réduit en aucun cas à cette simple fonction. Cette conception appauvrie de la conscience permet peut-être de redonner sa dignité à la nature, comme le souhaite Jonas, mais ce serait nier toute celle de l’homme.
Ainsi, si la conscience est bien l’un des moyens que nous avons pour éviter la mort, elle ne se limite pas à cela. Comme le soutient Jonas, elle est un moyen asservi à une fin (la survie) qui est lui-même devenu une fin. La conscience est, « au-delà de toute instrumentalité, […] pour elle-même et une fin en elle-même ». « C’est la logique subtile de la vie d’utiliser des moyens qui modifient la fin et deviennent eux-mêmes une partie de celle-ci. » (idem, p.46.). La conscience nous a permis de nous opposer au « non », et nous le permet encore aujourd’hui, mais elle s’est transformée en un des aspects de la finalité de la vie humaine. Même un homme très gravement malade, s’il désire survivre, souhaite le faire en tant qu’être pensant. Il ne souhaite pas seulement survivre comme un être capable de métaboliser ou de sentir, mais surtout vivre consciemment. Cette fin en soi que représente la conscience est attestée par la façon dont le commun des mortels fait tout son possible pour conserver cette capacité. « La souffrance, comme le dit Jonas, s’accroche encore à elle-même». La vie proprement humaine est une vie consciente. C’est cette possibilité d’extrême conscience (comparée à l’intériorité dont sont dotés certains animaux) qui donne toute sa valeur à la vie humaine.
Si elle n’est pas un saut par rapport au reste du vivant, la conscience humaine est unique par ses immenses capacités et place donc l’homme dans une situation unique par rapport à l’ensemble du vivant.
L’homme est le seul à savoir qu’il doit mourir. En ce sens, c’est un regard de la vie sur elle-même. Et si nous définissons la vie comme provenant de l’être, sans que celui-ci l’ait prévu d’avance (cela supposerait une conscience), la conscience est ce qui permet à l’être de s’auto-refléter. Nous provenons de l’être et pouvons interroger cet être. C’est sûrement là l’une des plus étonnantes particularités de la vie. Par l’homme, la vie peut s’observer, se questionner, se connaître. Même si nous pouvons, avec Jonas, soutenir que les animaux possèdent une certaine intériorité, ce n’est qu’avec la conscience humaine que la vie peut prendre véritablement conscience d’elle-même. Nous ne soutenons pas par-là que ce regard sur soi était prévu, visé par l’être depuis la nuit des temps, mais tout simplement que l’homme, qui appartient au monde vivant et à la nature, a la formidable capacité de se retourner sur ceux-ci et que, ainsi, la vie peut se tourner vers elle-même et vers ce dont elle provient : l’être. Et cette capacité est devenu une fin en soi pour l’homme.
L’homme, donc, est le seul être vivant à être conscient qu’il est mortel. Il sait tout d’abord qu’il peut à chaque instant mourir, du moins peut-il s’en rendre conscient. C’est le premier sens de la mortalité que relève Jonas : le pouvoir mourir. Mais à ce premier sens, dont nous avons déjà parlé, s’ajoute une autre dimension : celle du devoir mourir. Si la possibilité de la mort désigne avant tout la possibilité de la mort violente, la nécessité de mourir, elle, n’est autre que le terme inéluctable de toute vie, le point final. Encore une fois, seul l’homme a la capacité de prendre conscience de la finitude de toute vie, à commencer par la sienne. Seul un être humain sait que sa vie n’est pas éternelle et connaîtra, à un moment ou à un autre, une fin.
D’ailleurs, c’est peut-être grâce à cette conscience de notre inévitable finitude existentielle que nous pouvons donner un sens à notre vie. C’est en tout cas ce que soutient Jonas, héritant sûrement sur ce point de la pensée de l’auteur de Sein und Zeit, qui fut l’un de ses professeurs. « Quant à chacun d’entre nous, le fait de savoir que nous ne sommes ici que brièvement et qu’une limite non négociable est imposée à notre espérance de vie, peut même être nécessaire comme un encouragement à compter nos jours et à les faire compter. » (idem, p.52.). Pour Jonas, le fait de compter nos jours, de savoir que nos jours sont comptés est ce qui permet à l’homme de faire compter ses jours, de leur donner de la valeur. Cette thèse n’est pas sans rappeler le Dasein et l’être-pour-la-mort. Si Husserl, dont Jonas fut également l’élève, insiste avant tout, notamment dans ses Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, sur la temporalité passée, l’horizon passé de toute existence (Il suffit, pour s’en rendre compte, de voir le peu de place attribuée au phénomène de la protention par rapport à celui de la rétention, l’analyse de ce premier n’occupant qu’un seul paragraphe (§24). Husserl semble avant tout insister sur le fait que toute perception présente se déroule sur fond d’un passé sédimenté.), Heidegger, quant à lui, met l’accent sur l’horizon futur du Dasein. Ce dernier est métaphysiquement défini comme celui qui peut se poser la question de l’être. Cette interrogation, tombée dans l’oubli (§1), est pourtant l’un des modes essentiels du Dasein. C’est d’ailleurs ce qui le différencie des autres étants. Du fait qu’il est en relation avec l’être, qu’il est un être ontologique, le Dasein se distingue ontiquement des autres étants, son mode d’être n’est pas le même. Mais en se définissant par cette interrogation, le Dasein se définit alors par le souci, car en interrogeant son propre être, il se rend compte qu’il est temporellement fini. Et c’est en se souciant que le Dasein va s’ouvrir à ses possibilités, c’est en prenant conscience de sa finitude existentiale (c’est-à-dire comme structure de son existence) que le Dasein va pouvoir vivre une vie authentique, c’est-à-dire une vie qui ne manque pas ce rapport au temps. En considérant la nécessité de sa propre mort, en l’anticipant, le Dasein va saisir sa temporalité et donc s’ouvrir à ses propres possibilités, se faire projet. La conscience de sa finitude permet donc au Dasein de se rapprocher de lui-même et de vivre d’une manière authentique, c’est-à-dire de prendre conscience de la temporalité de l’être et de l’horizon de finitude qui caractérise toute existence.
Mais aux yeux de Jonas, cette conception du souci chez Heidegger est trop centrée sur la subjectivité du Dasein. Si celui-ci se soucie de sa mortalité, c’est une « mortalité bien abstraite » dont il s’agit ici. L’une des nécessité de la pensée, pour Jonas, est de prendre en considération l’énoncé « j’ai faim ». Or le souci heideggerien ne signifie jamais le souci de la nourriture, les besoins physiques : « la philosophie allemande avec sa tradition idéaliste était en quelque sorte trop noble pour cela » (Hans JONAS, Pour une éthique du futur, trad. fr. S. Cornille et P. Ivernel, Paris, Rivage poche, 1993, p.40.).
Ce que critique ici Jonas, c’est l’héritage du dualisme métaphysique qui pousse à un « éloignement réciproque des parties d’un tout devenant étrangères l’une à l’autre » ( idem, p.41.). Selon Jonas, la philosophie, depuis le dualisme cartésien (substance étendue / pensante), n’a jamais traité de la totalité et s’est au contraire concentrée sur la subjectivité. L’analyse du Dasein que fait Heidegger ne déroge pas à ce constat. Le souci pour lui-même n’est jamais le souci concret pour sa survie, mais celui pour la finitude ultime de son existence. Pour reprendre le vocabulaire jonassien, le Dasein ne se soucie que de la nécessité de sa mort, mais jamais de la possibilité de sa mort : Heidegger n’a pas intégré l’organisme dans sa conception de l’homme. Il ne s’agit pas de remettre en cause la pertinence de la réflexion heideggerienne, mais de remarquer qu’elle se limite à la subjectivité et ne se soucie guère des besoins du corps. Pourtant, ceux-ci précèdent le souci de la finitude ultime. Dans notre société actuelle, il est clair que ce souci premier, celui de subvenir à ses besoins physiques, est estompé : la plupart des Français peuvent en effet manger à leur faim sans nullement s’en soucier. Mais ce n’est pas le cas de tous. Que ce soit en France ou dans des pays du sud, des millions d’êtres humains se soucient quotidiennement pour leur vie, leur survie. Ce souci de base est le souci de toute vie. La vie étant une fin de l’organisme, celui-ci fait tout ce qu’il peut pour l’assurer. Que ce soit pour transmettre son code génétique, ou tout simplement pour la vie elle-même, l’organisme tend vers la vie. Chez l’homme, cette recherche de l’accomplissement de la finalité que représente le vivre se fait sentir consciemment par le souci de se nourrir. Mais du point de vue de la conscience, il n’est véritablement souci que lorsque la menace du non-être se fait fortement sentir. C’est, il nous semble, pour cette raison que nos sociétés occidentales ne mesurent pas toute la valeur de la vie. N’étant pas, ou très peu, menacés par les problèmes concrets de survie nous avons tendance à ne pas prendre en compte l’importance du corps dans la vie. Il nous semble que c’est à cette prise en considération de l’organisme, comme lui-même tendant vers le « oui », que nous invite Hans Jonas. Mais Jonas ne limite pas la conscience à l’instrument au service de cette affirmation. Il ne fait que nous rappeler le rôle premier de la conscience, et comme il le dit, ce moyen est lui-même devenu une partie de la fin. En ce sens, il rejoint l’interprétation heideggerienne sur l’importance de la prise en compte de la finitude ultime de toute existence.
Toutes les manifestations de la conscience, qu’elles soient, par exemple, artistiques, politiques, techniques, ou éthiques font partie intégrante de la finalité de la vie humaine. C’est son aspect conscient (au sens fort du terme cette fois-ci) qui fait toute l’importance de la vie humaine. L’homme, en ce sens, occupe une place à part parmi les autres vivants : la dimension culturelle de l’humanité en fait son unique valeur. L’homme ne vit par seulement pour vivre, mais pour vivre humainement. Si tout homme ne développe pas ses capacités spirituelles de la même manière, la vie humaine peut être définie comme la possibilité de s’ouvrir à ce qui en fait sa richesse, à savoir la culture. C’est d’ailleurs par la transmission et la réappropriation continue de celle-ci que l’homme a évolué et développé toujours davantage sa conscience. L’homme peut vivre sans développer une sensibilité artistique, sans se soucier de morale ou des questions politiques mais il nous semble qu’il passe alors à côté de ce qui fait son humanité. Notons ici que la responsabilité est l’une des possibilité que la conscience ouvre à l’homme. Nous aurons le loisir de revenir sur celle-ci ultérieurement mais nous pouvons dès à présent annoncer que la responsabilité et cette intériorité propre à l’homme sont doublement liées. La responsabilité est d’abord celle de l’homme qui possède un esprit (même si le sentiment de responsabilité est sûrement premier) mais c’est aussi celle de l’homme envers l’homme en tant que possesseur de cette intériorité, en tant que subjectivité.
Jonas propose donc une conception moniste du vivant en tant que marqué de part en part par la finalité qu’est la vie. Tout organisme affirme constamment le « oui » de la vie. Le vivant est à comprendre téléologiquement. Expliquer ses mécanismes, par méthode, suppose la négation de cette finalité. C’est ainsi que procède la biologie et c’est sûrement ainsi qu’elle a pu connaître tous ses succès. D’un point de vue pragmatique, il faut défendre le principe d’objectivité. Mais nous avons vu qu’il est obtenu au prix d’un coup de force métaphysique qui restreint arbitrairement l’assignation de fins (plus ou moins conscientes et non conscientes) à l’homme. Jonas, pour sa part, récuse ce curieux partage et étend l’intériorité au-delà de la seule sphère de l’homme. Mais surtout, il établit la présence de fins (non conscientes, non représentées, si ce n’est en l’homme) dans la nature elle-même, dont il trouve une expression dans le métabolisme qui est l’agir de tout vivant pour rester en vie. Une fin traverse tout le phénomène de la vie : c’est la vie elle-même. Ce n’est pas la seule, sinon la vie humaine ne vaudrait d’être vécue. Mais c’est en tout cas une fin objective que la nature manifeste par la vie. S’il fallait résumer en une phrase la conception de la vie que nourrit Jonas, ce serait que la vie dit oui à la vie. En ce sens, la vie est caractérisée par une unité profonde.
Mais ce n’est pas pour autant que Jonas s’oppose à la suprématie de l’homme sur tous les autres organismes. Son but est de rendre sa dignité à la nature, de s’opposer à la neutralité que lui confèrent les sciences et qui autorise alors tous les excès, notamment technoscientifiques. Cependant, la culture humaine a infiniment plus de valeur que n’importe quel autre phénomène biologique, et Jonas en est conscient. Si la vie est une merveille, si la conscience s’est forgée petit à petit et n’est pas apparue seulement chez l’homme, l’esprit humain est sûrement l’une des plus merveilleuses créations (inconscientes) de la nature. Si donc la conception jonassienne de la vie est moniste, elle prend tout de même en compte la rupture profonde qu’instaure la conscience humaine dans l’unité de la vie. Ainsi, l’homme responsable l’est avant tout vis-à-vis de l’homme en tant qu’ils partagent la communauté de l’humanum. « Tout être vivant est sa propre fin qui n’a pas besoin d’une autre justification, et de ce point de vue l’homme n’a aucun avantage sur d’autres vivants […]. Mais les fins de ceux qui partagent avec lui le son humain, qu’il les partage lui-même ou qu’il les leur reconnaisse seulement, ainsi que la fin propre ultime de l’existence comme telle, peuvent être incorporées de manière singulière dans la fin propre » (Hans JONAS, Le principe…, op. cit., p.193.). La vie humaine se distingue de toutes les autres formes de vie en tant qu’elle peut être consciente d’elle-même et se poser des fins propres. La nature « poursuit » elle aussi des fins, notamment avec l’apparition de la vie, mais ces fins ne sont pas représentées ni prévues. S’il y a bien une continuité entre l’homme et les autres créations vivantes de la nature, elle n’est pas totale. Nous pouvons admettre une intériorité chez certains animaux et un certain poids causal de celle-ci, mais elle ne peut avoir de commune mesure avec la conscience humaine. La capacité humaine de se poser des fins est unique. Jonas ne remet pas en cause la dignité de la conscience humaine. Mais il considère que la conscience humaine est double.
Si elle est ce qui peut élever l’homme à un statut unique parmi le vivant, elle peut aussi le rabaisser. « Dans l’esprit, noblesse et fatalité se rencontrent » (Hans JONAS, Pour une éthique du futur, op. cit., p.61). La noblesse de l’esprit réside dans la capacité qu’elle a de porter l’homme à un statut de métaphysicien. L’homme n’est pas seulement un être sentant : il peut penser et, par des concepts, interroger le monde. Cette noblesse est la valeur intrinsèque de l’esprit. C’est ce qui fait l’unicité de l’homme. Mais à ce premier aspect positif se mêle un autre aspect qui, lui, peut être perçu comme négatif. Il s’agit cette fois de la valeur instrumentale de la conscience. Comme nous l’avons vu, l’esprit a d’abord été un moyen de survie pour l’organisme avant de s’accomplir en lui-même et de devenir une fin en soi. C’est cet usage instrumental de la raison, au service du corps, que Jonas conçoit comme négatif. Non pas en lui-même, mais pour les conséquences qu’il provoque. En effet, pour les plaisirs du corps, l’humanité consomme de plus en plus. Que ce soit en nourriture, en loisirs ou en matériel, l’homme a de plus en plus d’envies et se crée de nouveaux besoins. Si ce besoin est sûrement inscrit au plus profond de l’homme, la consommation actuelle est telle qu’elle se retourne contre lui. L’esprit, au service du corps, en vient à le mettre en péril. Nous reviendrons sur ces problèmes de pollution et de consommation dans la prochaine partie. Et si l’esprit au service du corps amène des conséquences fâcheuses pour l’environnement et pour l’humanité, ses besoins propres n’en amènent pas moins. Les loisirs « intellectuels » sont eux aussi de gros consommateurs de matière. Pensons par exemple à l’industrie du cinéma, à son énorme consommation d’énergie et de matériaux. Que ce soit pour des plaisirs corporels ou intellectuels, l’humanité a donc besoin de toujours plus de matière et d’énergie. En ce sens, « l’esprit a fait de l’homme la plus vorace de toutes les créatures. » (idem, p.60.).
Cette voracité pourrait, à plus ou moins long terme, être fatale pour l’homme lui-même. Et si Jonas revient sur le rôle primitif de la conscience, c’est pour nous rappeler que la conscience véritablement humaine, la conscience métaphysique est capable de mettre en danger son propre présupposé : la vie. La conscience n’est pas un simple instrument au service de l’humanité pour assurer sa survie, mais elle s’oppose à elle-même lorsqu’elle se pose des fins qui mettent en danger la fin objective qu’est la vie. La conscience métaphysique est bien une fin en soi, mais elle ne doit jamais se mettre elle-même en jeu. Or, c’est ce qu’elle fait quand elle adopte un mode de vie dont elle ignore les conséquences lointaines et qui peut mettre en jeu la vie de l’humanité.
Finalement, en réintroduisant d’une manière rationnelle la finalité dans la nature, Jonas nous pousse à nous interroger sur le phénomène de la vie et à voir en lui une affirmation constante de l’être. A ce « oui » s’oppose le « non » du mode de vie des sociétés libérales actuelles qui menace la nature et, en son sein, l’homme. Cette façon de vivre est le fruit de l’esprit humain qui cherche son plaisir et celui du corps. Pour mettre en cause celle-ci, Jonas s’appuie sur Darwin et soutient la continuité entre le corps et l’esprit, en soutenant que la finalité est déjà à l’œuvre dans l’être, ne se réduisant pas à un phénomène de la conscience. Mais cette immanence des fins dans l’être ne suffit pas pour que l’homme ait à se sentir responsable de celles-ci. Pourquoi devrait-il renoncer à certaines de ses fins propres, subjectives, au profit de la fin objective qu’est la vie ? En outre, il s’agit de se sentir responsable de l’existence de l’humanité. Nous verrons que tout cela exige un retour à la question de Leibniz : pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien ? Bref, nous nous tournons à présent vers la responsabilité.
Plan de l’étude de Hans Jonas * :
- Intro
- I- Les fondements biologiques de l’éthique de la responsabilité
- II- La responsabilité envers les générations futures
- III- Générations futures et populations actuellement damnées
- Conclusion
