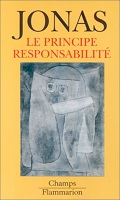 La présence de fins dans la nature est l’un des piliers de l’éthique de la responsabilité, elle en est un fondement nécessaire. Pour soutenir la nécessité de préserver l’existence de l’homme (mise en danger par notre immense pouvoir technologique) dans la nature, Jonas doit auparavant montrer que la vie est une fin en soi que poursuit l’être. A partir de cette immanence des fins dans l’être, dont la vie fait partie, Jonas conclut que préserver l’humanité d’une disparition prématurée constitue un devoir pour l’homme. Mais cette conclusion n’est pas immédiate. Cela suppose de savoir pourquoi quelque chose doit être plutôt que rien, c’est-à-dire de faire un détour par Leibniz.
La présence de fins dans la nature est l’un des piliers de l’éthique de la responsabilité, elle en est un fondement nécessaire. Pour soutenir la nécessité de préserver l’existence de l’homme (mise en danger par notre immense pouvoir technologique) dans la nature, Jonas doit auparavant montrer que la vie est une fin en soi que poursuit l’être. A partir de cette immanence des fins dans l’être, dont la vie fait partie, Jonas conclut que préserver l’humanité d’une disparition prématurée constitue un devoir pour l’homme. Mais cette conclusion n’est pas immédiate. Cela suppose de savoir pourquoi quelque chose doit être plutôt que rien, c’est-à-dire de faire un détour par Leibniz.
Ainsi le fondement biologique analysé précédemment est-il nécessaire, mais pas encore suffisant : il faut lui adjoindre une métaphysique d’inspiration leibnizienne. Dire que la vie est une fin ne suffit pas pour défendre l’existence future de l’être comme tel de l’homme. Or il s’agit, avec Jonas, de défendre une existence future véritablement humaine de l’homme. La question est donc : « que voulons-nous dire, quand nous disons de quelque chose que « cela doit être » ? », ce qui renvoie à la grande question de Leibniz.
Contrairement à l’attitude scientifique qui, par définition, se pose la question du comment, il s’agit ici de savoir pourquoi l’humanité doit exister. Cependant, il ne s’agit pas du pourquoi dans le sens de l’origine, de la cause première. De plus la question est indépendante de « toute thèse concernant son auteur » (Hans JONAS, Le principe…, op. cit., p.103.). La foi n’est donc pas nécessaire pour aborder cette question. En ce sens, Jonas s’éloigne de Leibniz pour qui la raison suffisante des choses et du monde en son ensemble est à chercher en une substance primitive, divine : la « dernière raison des choses est appelée Dieu.» (LEIBNIZ, Principes de la Nature et de la Grâce fondés en raison, §8.).
Le pourquoi est au contraire à comprendre dans le sens du pour quoi, c’est-à-dire comme le dit Ricoeur, du « cela vaut-il la peine d’être ? » (op. cit., p.311.). La question leibnizienne devient alors celle-ci : l’humanité vaut-elle la peine d’exister ? Ou encore : pour quoi l’humanité existe-t-elle ? C’est d’ailleurs en interrogeant la raison d’être des choses que nous accédons à la métaphysique.

Dans les Principes de la Nature et de la Grâce, Leibniz distingue deux questions qui se posent, une fois le principe de raison suffisante adopté. Se demander si quelque chose doit être peut être entendu, en effet, en deux sens bien distincts. Cela peut revenir, en premier lieu, à se demander si une chose doit être plutôt que de ne pas être, ce qui revient à interroger l’être de quelque chose sur le fond de son non-être, de sa possible disparition : l’alternative est celle de l’être ou du néant, le néant étant « plus simple et plus facile que quelque chose » (LEIBNIZ, Principes de la Nature et de la Grâce fondés en raison, §7.). La question première est donc : « pourquoi il y a plutôt quelque chose que rien ? » (idem.). Et telle est la question que nous pousse aujourd’hui à nous poser notre immense pouvoir technologique qui, par ses effets négatifs, secondaires, peut faire jouer son va-tout à l’humanité. Se demander si l’homme doit être présent sur le globe n’a ici de sens que dans la mesure où cette présence peut être écourtée par l’action de l’homme lui-même, notamment par le déséquilibre des écosystèmes qu’occasionne la consommation énergétique des artefacts technoscientifiques.
En second lieu, la question peut être celle de la raison de l’être-tel d’une chose : la question porte sur les aspects de l’être, sur ses différentes alternatives. Pourquoi les choses sont-elles telles qu’elles sont ? Le choix n’est plus entre l’être et son contraire, mais entre l’être ceci et l’être cela. En ce qui concerne l’homme, c’est ici l’idée de celui-ci qui est en jeu. Pourquoi l’homme est-il tel qu’il est ? Dans le cadre de la réflexion jonassienne, cette question, à son tour, n’a de sens que parce que l’être tel de l’homme peut être modifié grâce à notre pouvoir technoscientifique. Il aborde d’ailleurs trois cas de modification de l’homme par l’homme dans le premier chapitre du Principe responsabilité. La première « amélioration » est la prolongation de la vie. L’immortalité est toujours un rêve, mais l’augmentation de l’espérance de vie grâce à l’absorption de pilules est apparemment devenue une réalité (la D.H.E.A.). En second lieu, il évoque la possibilité, la menace de voir les comportements des individus contrôlés par des produits chimiques ou des impulsions électriques. Si ce contrôle peut être utile dans certains cas (soulager le patient), il y a le risque d’étendre ce soulagement à la société, et d’aboutir à une manipulation sociale. Enfin, il évoque le risque des manipulations génétiques, qui sont de plus en plus une tentation pour l’homme. Quel parent ne rêve pas d’avoir un enfant parfait, sans malformation ni imperfection ?
Jonas reprend les deux questions qui, chez Leibniz, découlent du principe selon lequel rien n’est sans raison, sans cependant adopter ce principe comme présupposé. Tout comme lui, il affirme la priorité de la première question sur la seconde. Si, selon Jonas, c’est une existence véritablement humaine qu’il faut préserver, c’est d’abord l’obligation d’exister de l’humanité qu’il faut fonder. En effet, nous pourrions penser, au premier abord, que l’obligation de perpétuer l’humanité n’a pas à être fondée, que cette fondation est même inutile car l’instinct sera toujours là pour assurer notre descendance, car il y aura toujours des hommes pour se reproduire, avoir des enfants et permettent ainsi à l’humanité de continuer à exister. De plus, les causes externes d’une destruction totale de l’humanité semblent improbables. Enfin, ce qui menace l’être-tel de l’homme semble également menacer l’existence de l’homme. Nous pourrions seulement postuler l’existence future de l’humanité et ainsi nous concentrer sur la deuxième question, concernant l’essence de l’homme.
Mais un pessimiste, confronté à un scénario sombre concernant la qualité de la vie humaine dans un futur plus ou moins proche, pourrait tout à fait défendre l’obligation de ne pas exister de l’humanité future, puisque les conditions de son existence future ne seraient pas humainement satisfaisantes. Jonas rapproche cela d’un argument fréquent au cours de l’ère hitlérienne, selon lequel dans un monde aussi atroce, mieux vaut ne pas transmettre ces atrocités à ses enfants et donc ne pas procréer (Hans JONAS, Le principe…, op. cit., p.92.). Cela revient à faire dépendre « le caractère souhaitable ou obligatoire de l’humanité future des conditions prévisibles de leur existence » (idem.). C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’obligation absolue d’exister pour l’homme. Si ses conditions d’existence sont premières, le caractère tout au moins souhaitable de son existence est relatif à la forme de son existence. Ainsi, confronté à une prévision sombre de l’être de l’homme dans le futur, le pessimiste pourrait défendre l’obligation de ne pas être de l’humanité. Mais Jonas ne veut pas pour autant défendre que l’existence future de l’humanité peut être achetée à n’importe quel prix, au contraire.
S’il défend la priorité de l’obligation d’exister sur celle de l’être-tel de l’homme, cette dernière est cependant bien une obligation. Le premier impératif est qu’il faut qu’une humanité soit. L’impératif selon lequel l’homme doit vivre humainement est second. Mais il s’agit, dans l’éthique de la responsabilité, de défendre la présence future d’humains véritables, d’individus ayant la possibilité d’être pleinement humains. Nous verrons ultérieurement qu’il s’agit d’être responsable de l’humanité en tant qu’elle peut être responsable. Pour l’instant, nous avons donc vu que fonder la nécessité de l’existence de l’humanité doit précéder celle de son être-tel.
Pour fonder le devoir être de l’homme, Jonas reprend l’interrogation leibnizienne. Nous avons auparavant distingué les deux questions leibniziennes. Si la réponse à la deuxième est relative, nous ne pouvons répondre que d’une manière absolue à la première. Savoir si quelque chose doit être plutôt ceci ou plutôt cela s’inscrit dans les limites de l’être. Le choix se fait toujours entre tel ou tel mode d’être. Par contre, répondre à la première question ne peut se faire qu’absolument : soit l’être en soi est bon, soit il vaut mieux lui préférer le néant. Appliquons cela au cas de l’homme.
Nous pouvons penser que l’homme doit être plutôt comme ceci que comme cela : nous émettons alors une préférence pour un certain mode d’être de l’homme. Quelle que soit cette préférence, elle s’inscrit toujours dans certaines limites, celles de l’être. Mais nous pouvons également penser qu’il vaut mieux que l’humanité existe, plutôt qu’elle ne soit pas. Ici, le choix se fait entre l’être et son contraire. Cela revient à dire que face à tous les différents modes d’être d’une chose, en l’occurrence de l’homme, nous pouvons toujours préférer le non-être. Ainsi avons nous d’un côté l’être, avec toutes ses modalités possibles, et de l’autre, le néant : « je dis qu’à la place de toutes les alternatives de l’être on peut choisir le non-être » (JONAS, Le principe…, op. cit., p.100.). C’est en ce sens que l’obligation d’exister de l’humanité doit être fondée avant celle de l’être véritable de l’homme, car face à tel ou tel mode d’être de l’homme, nous pouvons toujours choisir le non-être.
En fait, la deuxième question leibnizienne est un prolongement de la première, elle est inscrite en celle-ci. Ce n’est qu’une fois que nous avons posé la raison d’être d’une chose que nous pouvons penser la raison de l’être-tel de celle-ci : « supposé que des choses doivent exister, il faut qu’on puisse rendre raison, pourquoi elles doivent exister ainsi, et non autrement » (LEIBNIZ, op. cit., §7 (nous soulignons).).
« Pourquoi y a-t-il plutôt quelque chose et non pas rien ? » est donc d’abord à entendre comme un questionnement de l’être sur le fond du néant. Le problème principal pour Jonas est alors de savoir si l’être a plus de valeur que le non-être. En ce sens, s’il reprend bien l’interrogation leibnizienne, il lui fait cependant subir un fléchissement axiologique. Il s’agit de savoir ce que nous voulons dire lorsque nous disons que quelque chose a de la valeur.
Lorsque nous disons que quelque chose a de la valeur, nous disons par là que cette chose doit exister. En se prononçant en faveur de la valeur d’un étant, nous nous posons en faveur de l’existence de cet étant. En ce sens, « la valeur ou le « bien » […] est l’unique chose dont la simple possibilité réclame déjà l’existence (ou dont l’existence une fois donnée réclame légitimement la continuation de son existence) – qui fonde donc une revendication d’être, un devoir-être » (JONAS, Le principe…, p.104.). Attribuer, par exemple, de la valeur à l’homme, c’est préférer son existence à sa disparition. Comme le note Ricoeur dans son article consacré au philosophe allemand, valeur et existence vont de pair dans la question leibnizienne.
Cette coïncidence fait que la valeur ne peut se trouver que du côté de l’être. Se demander si quelque chose a, ou non, de la valeur, « c’est déjà se placer dans une perspective où il a déjà été décidé de la préférence de l’être au non-être » (RICOEUR, op. cit., p.311.).
En effet, le non-être n’est pas susceptible de valeur. Seul ce qui est peut avoir une valeur, et, d’un autre côté, ce qui a de la valeur revendique l’existence ou la continuation de son existence : « tout se concentre ainsi sur la question de savoir s’il y a seulement quelque chose de tel que « la valeur » » (JONAS, Le principe…, op. cit., p.105.).
L’existence de valeurs dans le monde humain est une évidence. Tous les hommes n’attribuent pas la même valeur aux choses, mais il semble indubitable que tout homme cultive des valeurs, dans le sens où chacun défend l’existence de certaines choses, qu’elles soient immatérielles ou matérielles. L’homme est un être qui peut évaluer les choses. Le philosophe n’est-il pas un homme qui attribue de la valeur au fait de philosopher ? Le footballeur n’attribue-t-il pas de la valeur à son sport de prédilection ? Au moins en un sens subjectif, l’existence de valeurs est un fait. Mais ce subjectivisme de la valeur n’est pas suffisant car il peut être assimilé au relativisme : chacun élabore des valeurs propres à lui-même, n’ayant rien d’universel, et répondant à des inclinations personnelles. Et de ce relativisme des jugements de valeurs, il n’y a qu’un pas à faire pour tomber dans le nihilisme. La valeur, étant subjective, donc relative, n’existe pas d’une manière absolue. Certes, nous pouvons, par exemple, penser qu’un certain nombre de valeurs est partagé par les membres d’une même communauté. Mais dans tous les cas, « on peut toujours douter si tout ce drame pénible et effroyable en vaut la peine, si la grande attraction n’est pas une grande mystification » (idem.). C’est pour réfuter les objections nihilistes de ce genre que Jonas recherche une objectivité de la valeur. Mais où pouvons-nous trouver la présence d’une valeur objective, indépendante de jugement subjectif ?
Cette présence objective de valeurs, nous l’avons déjà abordée dans notre première partie : il s’agit de la vie. Nous avons vu que l’être, au travers du vivant, s’affirme lui-même : la vie est une fin objectivement présente dans la nature. Mais pouvons-nous assimiler cette fin à une valeur ? Le vivant implique-t-il son devoir-être ?
Au début du troisième chapitre du Principe, Jonas analyse le rapport entre la fin et la valeur. Tout d’abord, la fin n’est pas la valeur. La première est le « en vue de quoi » d’une chose. C’est le but, la fonction que remplit quelque chose. Mais « ma constatation que ceci est la fin de x, n’implique pas un jugement de valeur de ma part » (idem, p.107.). Reconnaître l’existence d’une finalité n’implique pas de lui attribuer de la valeur. En effet, la valeur peut être comprise en deux sens distincts. Tout d’abord, nous pouvons émettre un jugement de valeur d’un point de vue subjectif. Pour reprendre l’un des exemples de Jonas, nous pouvons regretter que les lions ne soient pas végétariens et donc voir négativement l’adaptation de leurs organes digestifs à un mode de vie carnivore. En ce premier sens, nous pouvons dévaloriser une fin objective et penser qu’il aurait mieux valu que les choses soient autrement.
Mais nous pouvons également nous placer d’un point de vue objectif, en évaluant quelque chose en fonction de sa capacité à atteindre sa fin. Nous n’évaluons pas ici la fin elle-même mais la plus ou moins grande réalisation ou non de celle-ci. Pour reprendre l’exemple précédent, nous pouvons alors attribuer de la valeur au système digestif du lion, qui est parfaitement adapté à sa finalité. Prenons un autre exemple jonassien : le marteau remplit sa fin qui est de marteler et a donc de la valeur, dans le sens où il est prévu pour remplir une fin déterminée. « Ce sont là alors des jugements de valeur mais ils ne reposent certes pas sur des décisions de valeur ou des fixations de fins de ma part : ils sont dérivés de l’être des choses correspondantes elles-mêmes et reposent sur la compréhension que j’en ai et non sur mes sentiments les concernant » (Jonas, Le principe…, op. cit., p.108.). Nous pouvons donc défendre l’existence objective de valeurs. Le Bien est alors compris comme la capacité à remplir une fin.
Nous avons déjà montré qu’il est possible d’assigner des fins à la nature. La vie, si elle n’est peut-être pas la seule fin que poursuit la nature, en est une. Si nous comprenons la valeur dans son sens objectif, nous pouvons alors assigner des valeurs à la nature, « car devant une fin déterminée de quelque manière que ce soit et recherchée de facto, son obtention dans chaque cas devient un bien et son empêchement un mal, et avec cette différence commence l’imputabilité de la valeur » (idem, p.158.). Si la vie est une fin de l’être, tout ce qui va dans le sens de l’affirmation de la vie est un bien. La présence de fins précède celle de valeurs : la fin est ce en fonction de quoi quelque chose a de la valeur ou non.
Jusqu’à présent, nous avons envisagé la valeur en fonction d’une fin déterminée, par exemple la vie. Mais qu’en est-il de la finalité en soi, du fait de poser des fins ? Est-elle elle-même susceptible de valeur objective? Pour trouver une réponse à cela, nous ne pouvons peut-être pas remonter au-delà de l’évidence. C’est en tout cas ce que pense Jonas. Celui-ci soutient que le fait d’avoir des fins est un bien en soi, supérieur à l’absence de fins : « dans la faculté comme telle d’avoir des fins, nous pouvons voir un bien-en-soi, dont il est intuitivement certain qu’il dépasse infiniment toute absence de fins dans l’être. J’ignore si ceci est une proposition analytique ou synthétique, mais il est impossible de revenir en deçà de l’auto-évidence quelle comporte. » (idem, p.159.). A cette thèse, Jonas oppose la doctrine du Nirvana qui, elle, défend l’absence de fins comme permettant à l’homme de bien vivre. Mais celle-ci est auto-contradictoire : elle critique le fait de poser des fins mais, ce faisant, pose une fin qui est de ne pas en avoir. C’est ce que Jonas nomme le paradoxe de la fin négatrice des fins. Il semble donc, à moins de souscrire à ce paradoxe (et peut-être même en y souscrivant), qu’il y ait une suprématie de la finalité sur l’absence de finalité.
En outre, et surtout, quand bien même cette thèse relèverait d’un choix métaphysique ne pouvant pas être prouvé, elle est appuyée par le phénomène de la vie, par lequel l’être se prononce en faveur de lui-même. Nous avons vu que le métabolisme, l’agir caractéristique du vivant, est un échange incessant entre l’organisme et son milieu, permettant à l’organisme de vivre. La vie est une lutte, une guerre. Elle doit sans cesse s’affirmer, car soumise en permanence à la possibilité de la mort. « Dans la vie organique la nature a déclaré son intérêt, et dans la diversité monstrueuse de ses formes, dont chacune est une manière d’être et de tendre vers un but, elle le satisfait progressivement au prix d’un empêchement et de la destruction correspondante. » (idem, p.161.). La vie est donc un phénomène qui nous montre que l’être se prononce toujours en faveur de lui-même. Cette affirmation de lui-même est mise en relief par la possibilité toujours présente du non-être à laquelle est soumis tout vivant. « Et c’est précisément ici, par la lutte de la vie contre la mort, que devient « emphatique » l’auto-affirmation de l’être » (idem, p.162.).
Dans notre première partie, nous avons vu que c’est en considérant la finitude de son existence que l’homme peut donner un sens à sa vie et vivre authentiquement. En ce sens, c’est la mort qui permet à l’homme de donner de la valeur à son existence, notamment en se posant des fins. Nous retrouvons ici le même rapport entre l’être et le non-être. C’est également la menace du non-être qui fait ressortir la valeur de l’être. C’est en se positionnant contre le non-être, que l’être apparaît comme une affirmation. C’est parce qu’il y a la possibilité de la mort que la vie apparaît comme une valeur que pose l’être : il y a une positivité du négatif.
C’est donc, en dernière analyse, sur le témoignage de la vie elle-même que Jonas fait reposer son intuition de la présence de valeurs dans l’être. Ce n’est certes pas une certitude, mais pouvons-nous attendre un savoir assuré de la part de la métaphysique ? Jonas lui-même nous avait prévenu : « nous ne pouvons pas faire l’économie de l’excursion risquée dans l’ontologie, même si le sol que nous pouvons atteindre ne devrait pas être plus sûr que n’importe quel autre sol auquel la théorie pure doit s’arrêter : il se peut qu’il soit toujours suspendu au-dessus d’un abîme de l’inconnaissable. » (JONAS, Le principe…, op. cit., p.98.). Mais la métaphysique que nous propose Jonas est une métaphysique rationnelle. Dans le pire des cas, le modèle que nous soumet Jonas peut n’être qu’une possibilité, une vision possible, parmi d’autres, du monde. Mais il nous semble qu’il a pour lui de répondre à une intuition très forte que tout un chacun peut avoir en contemplant les êtres vivants.
Nous avons donc vu que la valeur peut être objectivement présente dans l’être. Cela revient à dire que le vivant implique son propre devoir-être, puisque la valeur est ce qui exige l’existence de son objet, la continuation de l’existence de celui-ci.
Cependant, si nous en restons là, nous sommes face à une égalité de tout vivant : l’homme est un vivant parmi d’autres et n’a aucune suprématie, la vie humaine n’a pas plus de valeur que celle d’un autre organisme (Une telle position le rapprocherait alors du courant de l’écologie profonde (deep ecology) et de penseurs tels que Arne Naess ou bien encore Aldo Leopold).
Si Jonas a une conception moniste de la vie, nous avons également vu qu’il veut tenir compte du dualisme que l’apparition de l’homme introduit dans la biosphère. Cette dualité de la pensée jonassienne se retrouve ici, dans le sens où c’est avant tout l’homme qu’il s’agit de préserver. C’est la raison pour laquelle le fondement biologique est nécessaire mais pas encore suffisant. Ce n’est pas l’existence pure de l’homme qu’il faut préserver mais son existence proprement humaine.
Mais en disant cela, ne nous contredisons-nous pas ? En effet, nous avons dit auparavant que l’obligation d’exister de l’homme précède celle de son être-tel. Cela signifie que la seconde obligation ne peut être tirée que de la première. Et pour Jonas, avec la première obligation (l’humanité doit exister), nous avons des comptes à rendre à l’idée d’homme. Nous sommes responsables de celle-ci, et non véritablement des hommes à venir. Mais qu’est-ce que cette idée ?
Tout d’abord, c’est une idée ontologique. Cela signifie qu’elle exige l’existence d’occurrences : l’idée d’homme exige la présence d’hommes dans le monde. L’idée d’homme nous dit que l’homme doit continuer à être présent sur Terre. « Seule l’idée d’homme, en nous disant pourquoi des hommes doivent être, nous dit en même temps comment ils doivent être. » (JONAS, Le principe…, op. cit., p.95.). Mais que recouvre véritablement cette idée ? N’est-ce pas orgueilleux de prétendre que nous savons ce qu’est l’homme ? Jonas nous propose en effet une certaine idée de l’homme, mais pouvons-nous dire que c’est l’idée d’homme ?
Pour éclaircir cela, il nous semble indispensable de rappeler comment est obtenue cette idée. En effet, Jonas ne la conçoit pas ex nihilo. L’idée d’homme est donnée grâce à l’heuristique de la peur. C’est grâce à la prévision d’une déformation de l’homme que nous pouvons nous faire une idée de l’homme : c’est la menace contre l’homme qui fait apparaître ce qu’est l’homme et donc ce qu’il s’agit de préserver. « Nous savons seulement ce qui est en jeu lorsque nous savons que cela est en jeu. » (idem, p.66. ) Il est en effet plus facile de connaître le mal que le bien. Ce dernier peut très bien être présent sans que nous nous en rendions compte, alors que la présence du mal est bien plus aisée à percevoir. Pour appuyer cela, Jonas nous rappelle que la bonne santé est un bien qu’il est difficile d’appréhender en soi. C’est souvent grâce à la maladie que la bonne santé apparaît un bien. Ainsi l’heuristique de la peur est-elle indispensable pour l’éthique de la responsabilité : c’est en anticipant les dangers qui peuvent mettre en jeu l’homme que nous pouvons nous procurer « le concept d’homme qu’il s’agit de prémunir » (idem.).
Mais quelles sont les propriétés de l’homme qu’il faut préserver, quelle est l’essence de l’homme, bref : quel est le bien humain ? Contrairement au mal (les effets négatifs de nos artefacts technoscientifiques) qui peut menacer l’homme, le bien humain est loin d’être récent : « nouveaux sont les dangers, mais ancien le Bien » (« Sur le fondement ontologique d’une éthique du futur», in Pour une éthique du futur, trad. fr. S. Cornille et Ph. Ivernel, Paris, Rivage Poche, 1998, p.88.). Une première connaissance de ce Bien peut être tirée de l’histoire. Celle-ci nous montre ce que l’homme peut être, ses possibilités. Cela signifie que l’homme n’a pas à être, n’a pas à devenir, mais a, au contraire, déjà été : « dans son histoire, « l’homme » s’est déjà montré » (idem.).
Mais la connaissance sur l’homme que nous apporte l’histoire est une connaissance de type phénoménologique. Or ce que cherche Jonas, c’est une connaissance de type ontologique : il s’agit de découvrir l’idée ontologique de l’homme, c’est-à-dire ce qui fait que l’homme doit exister. L’histoire n’est donc pas une source suffisante. Elle nous montre que l’homme vaut la peine d’exister, que s’il s’est souvent montré misérable, il est également parfois apparu grand, sublime. Mais elle ne nous dit pas pourquoi l’homme doit absolument exister.
Comme nous l’avons déjà vu, c’est à la métaphysique qu’il revient de nous dire pourquoi l’homme a l’obligation d’exister. Mais nous avons également évoqué le fait que la métaphysique ne peut nous apporter aucune certitude. En outre, Jonas avoue lui-même que, si nous avons besoin de la métaphysique pour savoir pourquoi l’homme doit être, cela ne signifie aucunement que nous possédons une telle métaphysique : « moi non plus, je ne la possède pas » car la métaphysique est « plus éloignée que jamais de notre pensée positiviste » (idem, p.91.). Cependant, Jonas propose un point de départ pour une réflexion métaphysique tentant de nous dire ce qu’est l’homme, et donc ce qu’il s’agit de préserver. Ce point de départ n’est autre que le phénomène de la responsabilité lui-même.
Que l’homme soit le seul être capable de responsabilité est une évidence : c’est une donnée empirique. Mais pour Jonas, ce fait est plus que cela. La capacité de responsabilité permet d’obtenir une idée de l’homme : « nous y reconnaissons un critère distinctif et décisif de l’essence humaine dans sa dotation en être. » (idem, p.92.). Le pouvoir d’être responsable n’est donc pas simplement un fait empirique, c’est aussi une caractéristique ontologique : l’homme est un être pouvant être responsable. Cette responsabilité est une fin de la nature, une fin parmi d’autres, mais elle est plus que cela : la responsabilité transcende tout ce qui existait auparavant : elle « dépasse par un transcendement générique tout ce qui a existé jusqu’alors » (idem.). La caractéristique principale de l’essence de l’homme est donc la responsabilité, du moins la possibilité de celle-ci.
Que la responsabilité soit ce qui fait que l’homme vaut la peine d’exister, cela n’est pas sans rappeler la morale kantienne. Dans les Fondements de la métaphysiques des mœurs, Kant défend que l’homme est une fin en soi, d’où l’impératif pratique : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. » (2ème section, trad. Victor Delbos.). Et si l’homme est une fin en soi, c’est grâce à sa moralité. Sa capacité d’être moral fait sa dignité. « la moralité est la condition qui seule peut faire qu’un être raisonnable est une fin en soi ; car il n’est possible que par elle d’être un membre législateur dans le règne des fins. » (idem.). La parenté entre Jonas et Kant semble ici évidente.
Nous avons vu que la suprématie des fins sur leur absence est le fruit d’une intuition, qui est appuyée par le témoignage de la vie : que le fait d’avoir des fins ait de la valeur repose, en dernière instance, sur une intuition. En ce qui concerne la responsabilité, la même question se pose : a-t-elle de la valeur ? Et ici aussi, la réponse est la même. C’est encore sur une intuition que repose l’attribution d’une valeur à cette capacité de responsabilité. Mais rationnellement, il nous semble tout à fait acceptable de soutenir que la capacité d’être responsable caractérise l’homme et le rend digne d’exister.
C’est donc la responsabilité elle-même qui fait que l’homme doit exister. La responsabilité est au moins une raison pour laquelle l’homme a l’obligation d’exister, ou encore : la responsabilité est entre autres ce qui fait que la vie de l’homme vaut la peine d’être vécue. C’est ce qui distingue l’homme des autres vivants, et donc ce qui fait que la responsabilité est avant tout celle de l’homme envers l’homme : « l’archétype de toute responsabilité est celle de l’homme envers l’homme » (JONAS, Le principe…, op. cit., p.193.). Si nous sommes également responsables de la préservation de la nature, c’est avant tout parce que le destin de l’homme est indissociable de celui de la nature : tel est l’un des nombreux enseignements de la théorie de l’évolution. Nous devons donc préserver la nature dans le sens où nous venons d’elle et dans la mesure où notre survie dépend de l’état de l’environnement. Mais le commandement absolu qui doit venir limiter l’agir collectif est de ne pas mettre en jeu l’existence future de l’homme, cet impératif étant catégorique.
Plan de l’étude de Hans Jonas * :
- Intro
- I- Les fondements biologiques de l’éthique de la responsabilité
- II- La responsabilité envers les générations futures
- III- Générations futures et populations actuellement damnées
- Conclusion
