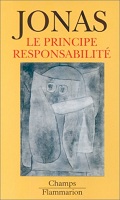 Si dans notre précédente analyse nous avons directement abordé la responsabilité envers les générations futures, nous nous tournons à présent vers le thème de la responsabilité envers les populations actuellement défavorisées. Nous défendrons, dans un premier temps, l’idée selon laquelle l’utopie technologique, si nous nous plaçons du point de vue des populations démunies et affamées, est à dénoncer et à combattre.
Si dans notre précédente analyse nous avons directement abordé la responsabilité envers les générations futures, nous nous tournons à présent vers le thème de la responsabilité envers les populations actuellement défavorisées. Nous défendrons, dans un premier temps, l’idée selon laquelle l’utopie technologique, si nous nous plaçons du point de vue des populations démunies et affamées, est à dénoncer et à combattre.
Nous verrons ensuite qu’au-delà des particularités communautaires, une transcendance de l’éthique par l’universel est une nécessité : au-delà des lois et morale d’un pays propres à lui-même et à sa propre population, la précarité d’une partie, qui plus est majoritaire, de la population mondiale nous oblige à élargir les frontières d’application de la justice sociale.
L‘utilisations de moyens technologiques dans la vie de tous les jours est une caractéristique loin d’être universellement partagée par l’humanité. Rappelons en effet que les trois quarts de la population mondiale rencontrent des problèmes concrets de survie au quotidien et que 60 ? des êtres humains connaissent la famine. Les nouvelles technologies sont un luxe pour la majorité des hommes peuplant la planète. Pour schématiser, il y a d’un côté des hommes qui peuvent regarder la télévision, utiliser une voiture, « surfer » sur Internet, bénéficier des dernières avancées de la technologie, manger à leur faim et même davantage ; de l’autre côté, des hommes qui n’ont pas ou à peine de quoi se nourrir, qui n’ont pas les moyens de bénéficier des progrès sanitaires et médicaux, qui n’ont pas de toit, ou possèdent un abris vétuste, souvent insalubre. Si cette vision du monde est certes caricaturale, les inégalités sont pourtant loin d’avoir disparues avec le libéralisme et la mondialisation des échanges. Nous pouvons même penser qu’elles se sont accrues avec l’ouverture mondiale du marché et des divers échanges. Au XXIème siècle, comme à la fin des années 70 (l’ouvrage de Jonas date de 1979), nous avons d’un côté les favorisés, le camp des privilégiés et, de l’autre, les damnés de la terre.
Le problème moral posé par cette inégalité flagrante, d’autant plus visible avec les moyens actuels d’information dans les pays développés, nous semble être l’un des principaux problèmes (avec celui des conséquences négatives pour l’homme de l’utilisation importante des objets technologiques) que l’humanité aura à résoudre durant ce siècle commençant. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de montrer que laisser quelqu’un mourir de faim n’est pas moins grave que de le tuer.
Si nous souhaitons souligner l’importance de ce problème, c’est aussi parce qu’il nous semble que Hans Jonas lui-même lui en accorde. Il suffit pour s’en rendre compte de relever que l’inégalité est abordée dans le dernier chapitre du Principe responsabilité et que cette partie de l’ouvrage est d’une importance capitale pour l’argumentation générale. Ce même thème apparaît une seconde fois dans la pensée jonassienne dans la conclusion d’un texte fortement remarquable que nous avons déjà cité : le fardeau et la grâce d’être mortel.
Plusieurs raisons peuvent nous pousser à adopter une attitude critique vis-à-vis du libéralisme sauvage actuel et de la promotion de la consommation et, comme le dirait Erich Fromm, du mode d’existence avoir. En nous plaçant du point de vue des opprimés, l’une des raisons est écologique. En effet, si la majorité des pays en voie de développement est écartée de la sphère de la sur-consommation, elle hérite pourtant d’inconvénients liés à la production, notamment d’aliments, pour cette consommation. L’utilisation excessive d’engrais, si elle a fortement reculé dans les pays au niveau de vie élevé, existe toujours dans les pays les plus pauvres. Outre la contamination des sols et leur appauvrissement progressif, cela n’est pas sans poser des problèmes de santé. De nombreux cancers se développent dans les populations vivant à coté de zones de culture ou manipulant régulièrement des produits nocifs pour la santé, dont font partie les engrais que nous avons précédemment abordés.
D’une manière générale, les industries les plus polluantes sont délocalisées vers les pays en voie de développement. « les pays en développement sont mal protégés contre les dangers de pollution, ils ne possèdent pas de législation aussi contraignante que celle des pays riches. Ils sont donc des lieux possibles d’implantation des usines les plus dangereuses » (1). Les pays riches bénéficient ainsi de produits dont l’élaboration coûte cher aux pays pauvres : le prix est écologiques et sanitaire.
Enfin, l’exploitation de certains ouvriers du tiers monde par de grandes firmes multi-nationales, certaines étant pourtant très réputées, nous pousse à adopter une attitude critique face à l’utopie technologique qui a envahit le monde humain. Il n’est pas sûr que l’esclavage fasse partie du passé. Il faut même se rendre à l’évidence que le système économique actuel favorise la domination d’un petit nombre d’hommes sur la majorité de l’humanité.
Nous avons, pour l’instant, seulement évoquer la responsabilité, dans le sens de l’imputation causale, des pays riches envers les populations défavorisées : nous sommes plus ou moins directement responsables de la dégradation des conditions de vie de nombreuses populations démunies. Etant causalement responsables de certains facteurs qui font que les pays pauvres restent pauvres et que certains s’appauvrissent toujours plus, nous avons l’obligation morale de réparer les torts que nous causons à ces populations.
Mais au-delà d’une quelconque imputation causale, il nous semble qu’une aide humanitaire conséquente est une obligation qui émane objectivement des populations en détresse et oblige absolument nos sociétés au train de vie aisé. Ce que l’humanité doit faire pour ses descendants, elle le doit tout autant aux générations présentes qui sont fortement exposées à la menace du non-être. L’analyse jonassienne de la valeur unique de la vie humaine, si elle vaut pour l’humanité, vaut également pour tout individu singulier. Un homme peut se suicider ou se laisser mourir, alors que l’humanité ne le peut pas. Par contre, l’humanité a le devoir de préserver toute vie humaine qui désire vivre, tout comme elle doit permettre aux futures générations futures de pouvoir exister. La possibilité de la vie humaine est un bien en soi que doit préserver l’homme. Nous ne devons pas empêcher l’existence d’homme dans un futur éloigné : tel est le commandement premier pour l’humanité exposé dans l’ œuvre éthique de Jonas. Nous devons permettre la possibilité de l’humanité, l’existence du miracle de la conscience à chaque fois qu’il est possible : tel est le commandement qui semble peu à peu apparaître vers la fin du Principe responsabilité.
La critique jonassienne des technosciences se fonde sur l’obligation qu’a l’homme d’exister et sur le fait que l’utopie technologique est en contradiction avec cet impératif. La nécessité de l’existence des générations futures est ainsi l’argument principal permettant de s’opposer à notre façon technologique de vivre. Cependant, si la critique des produits issus des technosciences a pour fin de préserver la possibilité d’une existence future de l’homme, il nous semble qu’une autre fin est visée : une meilleure égalité mondiale, une réduction des inégalités entre nantis et damnés.
Les générations futures sont certes ce qu’il s’agit de préserver ultimement mais il nous semble que cette préservation sert d’idée régulatrice, de limite ultime pour l’action humaine et que l’aide des populations actuellement en péril est le véritable but de l’éthique jonassienne. L’éthique que nous propose Jonas poserait ainsi un horizon que doit permettre l’agir humain (l’existence de générations futures) mais viserait surtout une meilleure répartition des conditions de vie.
Nous avons vu que l’avenir de l’humanité est déjà menacé par le mode de vie de nos sociétés, de notre « civilisation technologique » pour reprendre le sous-titre du Principe. Cet avenir se trouve d’autant plus assombri qu’un grand nombre d’hommes n’a pas encore accès au confort technologique et risque de bientôt y accéder, ce que finalement vise le mouvement de la mondialisation. L’extension du vivre technologique s’accompagnerait nécessairement d’une augmentation des rejets polluants, notamment issus de la production d’énergie, et donc, en dernière analyse, d’un risque chaque jour grandissant de voir l’humanité disparaître prématurément. L’humanité ne peut donc pas se permettre d’étendre le mode de vie d’une minorité (dont nous faisons partie) à l’ensemble des êtres humains. « Notre population utilise chaque année 230 kilos de papier par personne. Si nous vous laissons utiliser autant de papier que nous, c’en sera fini, dans quelques dizaines d’années, de la flore qui nous est indispensable pour vivre, et aussi de la faune dont la survie dépend de celle de la flore. Si chacun d’entre vous possédait aussi un réfrigérateur ou utilisait des sprays, la couche d’ozone, qui nous est nécessaire à tous, serait irrémédiablement détruite, avant que vous ayez fini de payer les traites de votre réfrigérateur. Et si chacun d’entre vous avait aussi un appartement et une voiture, cela signifierait la disparition des prairies et des forêts : nos enfants n’auraient plus de terrain de jeu. Vous exigez de partagez notre niveau de vie. C’est une agression contre nous, contre la prospérité de notre société, contre notre culture. Si nous vous donnions gain de cause, la nature serait détruite. Le monde serait inhabitable pour vous, mais hélas aussi pour nous. » (2). Face à l’impossibilité d’étendre notre niveau de vie à l’ensemble de la planète, deux alternatives s’offrent.
Nous pouvons tout d’abord penser qu’un niveau de vie faible pour une partie de l’humanité est une conséquence nécessaire et acceptable du libéralisme. Nous rejoindrions ainsi la pensée de Rawls.
Ce dernier, dans La théorie de la justice, énonce les deux principes qu’il juge être à l’origine de nos sociétés, notamment la société américaine. Ces deux principes sont justes car ils sont obtenus par des hommes placés « sous le voile d’ignorance » quant à leur future position sociale et qui doivent trouver un accord sur les principes d’une société juste. Cette pure fiction, cette expérience de pensée permet de dégager les deux principes suivants : « En premier lieu : chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de libertés de bases égales pour tous qui soit compatible avec le même système pour les autres. En second lieu : les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon à ce que, à la fois, (a) l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient à l’avantage de chacun et (b) qu’elles soient attachées à des positions et à des fonctions ouvertes à tous. » (3). Le premier principe est un principe d’égale liberté, le second un principe de différence. C’est sur ce dernier que nous nous penchons.
Ce principe, second dans l’ordre lexical, est double. Tout d’abord, les inégalités doivent être à l’avantage de chacun. Ainsi les plus défavorisés doivent-ils eux-mêmes bénéficier des inégalités sociales. Or, comme le défend notamment Jean-Claude Guillebaud, l’inégalité croissante aux Etats-Unis à partir de la fin des années 60 s’est « surtout traduit par un appauvrissement des plus pauvres »4. L’augmentation des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres a eu pour conséquence l’augmentation de la précarité des plus démunis. Le néolibéralisme américain n’est donc pas un système répondant aux deux principes inaliénables de Rawls. Les inégalités ne bénéficient pas au plus défavorisés. Mais cette baisse du niveau de vie des plus démunis n’est pas spécifique aux Etats-Unis : « le phénomène gagne peu à peu l’ensemble du monde développé, à un rythme variable selon les pays » (5). Le renforcement des inégalités mais surtout l’appauvrissement des personnes déjà les moins favorisées semblent être une conséquence inéluctable du libéralisme tel que nous le connaissons actuellement. Il semble que nous devons aujourd’hui accepter l’idée que les riches s’enrichissent toujours plus mais que les pauvres continuent, dans le même temps, de s’appauvrir.
Il est alors possible de concevoir le néolibéralisme comme une lutte pour la survie où les plus forts (économiquement) et les plus entreprenants assurent leur survie pendant que les moins forts sont exposés à la famine et à la menace de la mort. Le marché et la bourse jouent le rôle d’un filtre et élimine les individus qui n’ont pas su ou pas pu s’adapter au système économique. La question est de savoir si un tel processus de sélection est acceptable et s’il est humainement digne de laisser mourir des millions de gens. Car ce à quoi conduit le néolibéralisme, c’est à « l’extinction physique des moins aptes » (6) : la survie des plus pauvres n’est pas prévu par le libéralisme.
En ce qui concerne la deuxième partie du deuxième principe rawlsien, elle exige que les inégales positions sociales soient accessibles pour tous, y compris par les défavorisés et les plus pauvres. Or, nous pouvons nous demander si les différentes situations sociales sont vraiment ouvertes à tous. Nous laissons cette question ouverte.
Quoi qu’il en soit, il semble impossible de soutenir décemment la justice d’un tel système. Banaliser de telles injustices n’est tout simplement pas digne de l’homme. Cependant, il semble que la plupart d’entre nous se soit habituée à l’idée que de nombreux hommes ne peuvent pas survivre. Nous analyserons d’ailleurs de plus près cette attitude de détachement dans le deuxième temps de cette troisième analyse.
La deuxième alternative possible est de refuser de trop grandes inégalités et de lutter contre la pauvreté des plus pauvres, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. En adoptant un point de vue moral, il vaut mieux aider les plus pauvres et les empêcher de mourir que de les laisser à eux-mêmes et nous enfermer dans notre mode de vie agréable. Il est tout simplement immoral de soutenir que la mort de plusieurs dizaines de milliers d’enfants, de femmes et d’hommes chaque jour dans le monde est quelque chose à quoi nous devons nous résigner. Devant un constat aussi atroce, nous pouvons vouloir détourner notre regard, mais nous devons faire face à l’envers du système économique dans lequel nous évoluons. La Déclaration universelle des droits de l’homme ne dit-elle pas que « tout homme a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. » (7) ? Mais ce droit est loin d’être respecté aujourd’hui.
Que ce soit pour la raison que de nombreux hommes sont laissés à eux-mêmes à cause du néolibéralisme, ou parce que ce dernier n’est pas compatible, tel qu’il se présente jusqu’à aujourd’hui, avec un respect suffisant de la nature, il nous semble que notre système économique actuel doit être modifié ou être maîtrisé, jugulé par la sphère politique. Nous devons ici préciser que depuis le début nous avons pour présupposé que la course aux profits et la concurrence acharnée entre les entreprises, que le libéralisme économique aboutit à une augmentation et une diversification souvent excessive de l’offre, dont celle de produits technologiques, et conduit à une augmentation sans cesse croissante des rejets polluants, participant ainsi activement au réchauffement de la planète, phénomène qui menace véritablement l’humanité. Nous verrons ultérieurement que des mesures de restrictions font partie des solution aux problèmes qui menacent l’humanité future et présente.
L’un des problèmes qui se pose, lorsque nous abordons le problème des inégalités et de l’extrême dénuement de la majeure partie de la planète, est de savoir si nous pouvons élargir l’application d’une justice sociale au-delà des limites d’une nation, d’une communauté. La question est de savoir s’il est possible de défendre que nous devons, en tant que pays au niveau de vie aisé, apporter une aide conséquente aux pays qui n’ont pas les mêmes moyens que nous, quitte à sacrifier un peu notre confort. Une communauté universelle est-elle possible ? Telle est la question que se pose Michael Walzer à la fin de l’introduction de Sphères de justice : une défense du pluralisme et de l’égalité.
Plus précisément, il envisage une thèse différente de la sienne et s’en sert comme d’un repoussoir. Walzer soutient pour sa part la thèse de l’égalité complexe. Une société est composée de différentes sphères (qu’il ne définit pas de manière précise) qui, par une interprétation collective relative à chacune d’entre elles, déterminent ce qu’est le bien qui leur correspond. Le bien n’est pas le même d’une sphère à l’autre : la justice est multiple, relative. En ce sens, vouloir harmoniser les différents biens des communautés, ce serait pratiquer l’injustice. Cependant, il y a un principe unique à l’origine de la justice : la répartition ouverte (8). La justice distributive que propose Walzer doit tenir compte des diversités communautaires mais est unifiée par le fait que chaque communauté distribue les biens en tenant compte des m œurs du pays d’appartenance. Mais ce qui nous importe, c’est que la justice, la distribution des biens est relative à une communauté donnée.
Comme nous l’avons évoqué, Walzer envisage la possibilité, sans y adhérer, d’une communauté mondiale. Finalement, la justice doit-elle se limiter aux frontières d’un pays ou d’une communauté ? Walzer s’oppose pour trois raisons à la thèse de l’humanité comme communauté de référence pour l’application de la justice.
Tout d’abord, la communauté humaine n’existe pas encore. Si nous voulons nous y référer pour une distribution juste des biens, nous nous appuyons sur une fiction, une idée de la raison. La seule détermination certaine que nous pourrions donnée de cette communauté fictive serait géographique : la communauté humaine s’étend sur le globe entier, ou presque. Mais nous ne pourrions pas prendre une mesure correcte de ce que serait réellement une telle communauté : elle différerait de tout ce que nous connaissons dans nos communautés actuelles.
Ensuite, cette communauté imaginaire n’aurait pas de valeurs communes, de significations partagées. Il faudrait donc que l’humanité se forge des valeurs distinctes des valeurs particulières qu’ont les différentes communautés. La diversité culturelle est un fait et empêcherait donc la réalisation d’une communauté humaine planétaire.
Enfin, l’humanité en tant que communauté ne pourrait être que le résultat d’un contrat, d’un accord de chacun avec chacun. Ce ne pourrait pas être le fruit d’un accord entre les différentes communautés particulières. Et c’est là, selon Walzer, l’objection principale à la création d’une communauté universelle des hommes : la création d’une communauté à l’échelle de l’humanité ne pourrait que découler d’une pure et simple dissolution des communautés existantes, d’une destruction des appartenances qui nous définissent en grande partie.
Dans tous les cas, la création de la communauté humaine conduirait à un écrasement de l’individu par l’Etat. En détruisant les appartenances culturelles, l’individu se trouve en effet atomisé, vidé d’une part de son identité et nous aboutirions plus certainement à une forme de totalitarisme qu’à l’universalisme visé au départ.
Pour Walzer, la seule communauté véritable de référence pour l’application de la justice est donc politique. Seule la communauté politique existante permet de déterminer le bien relatif à une communauté. Cette communauté est le modèle de toutes communautés.
En ce qui concerne Jonas, il est évident qu’il s’oppose à cette conception limitative du bien. Le bien n’est pas seulement une création culturelle, relatif à des interprétations collectives mais existe objectivement dans la nature : la préservation de la vie, a fortiori humaine, est un bien auquel il serait absurde de vouloir assigner des frontières. Cependant, il est possible de trouver une complémentarité entre la pensée communautarienne et la pensée jonassienne.
Le bien est aussi une construction historique, relatif à une communauté donnée, qu’il s’agisse d’une ville, d’une région ou d’un pays : la conscience sociale reconnaît des m œurs comme bonnes ou mauvaises. Quelque chose précède toujours l’individu : une substance éthique, une Sittlichkeit. Le bien d’une cité ou d’un pays se détermine par une interprétation des significations partagées par les citoyens dans le vivre en commun. L’éthicité d’un peuple se traduit concrètement par l’existence d’éloges et de blâmes, de jugements moraux.
La détermination de ce qui est bien et de ce qui est mal est toujours relative à une communauté donnée, aucune communauté ne pouvant prétendre transcender les autres. Si, avec la Communauté Européenne, la diversité tend à s’amoindrir entre les différents pays membres, ces derniers conservent tout de même leur spécificité éthique construite historiquement. Chaque pays s’est construit une identité éthique propre à lui-même, s’exprimant par des m œurs déterminées, et grâce à laquelle l’individu va pouvoir constituer sa propre identité.
La subjectivité n’est en effet pas première. L’idée d’individus indépendants de toute détermination mais capables de se déterminer, comme c’est le cas dans le mythe de la position originaire chez Rawls, est une fiction car elle méconnaît ce qui précède la subjectivité : l’expérience de la vie en commun. L’individu se caractérise avant tout par une appartenance sociale, une appartenance à telle ou telle communauté à partir de laquelle il va pouvoir constituer son identité : le sujet n’est pas premier par rapport à ses fins. « Car avoir une personnalité, c’est savoir que je m’inscris dans une histoire que je ne demande ni ne commande et qui, néanmoins, a des conséquences sur mes choix et ma conduite. Elle m’amène à me sentir plus proche des uns, plus loin des autres. Elle me fait voir certains buts comme plus désirables que d’autres. » (9). La communauté transcende donc les individus et leur permet de se constituer.
Pour en revenir à la détermination de ce qui est bien, il est évident qu’elle ne peut se faire qu’en référence aux valeurs partagées par une communauté. Le bien tel que se le représente un Français n’est pas le même que le bien conçu par un Américain ou un Africain. Cependant, au-delà de telle ou telle conception historiquement et géographiquement constituée du bien, il nous semble que préserver la vie humaine est un bien qui ne relève pas d’une construction mais existe objectivement, comme nous l’avons montré dans notre seconde analyse. Pourquoi vouloir assigner des frontières à l’obligation d’assister toute personne en danger ? Le droit à la vie nous semble un droit inaliénable que, pourtant, une partie de l’humanité refuse à des millions de personnes.
La nécessité d’élargir le domaine d’application de ce qui est juste ou non à la planète découle notamment du fait que les diverses pollutions ne connaissent elles-mêmes pas de frontières : elles se déplacent grâce aux grands cycles naturels de notre planète. Pour permettre à l’humanité future d’exister et de bénéficier de conditions de vie acceptables, il faut dépasser les frontières et déterminer ce qui est bon ou mauvais, notamment en ce qui concerne l’utilisation des différentes technologies, le niveau de vie et, en général, la consommation, en fonction des ressources naturelles mondiales et des limites physiques (mais certes difficilement assignables) de la planète. Car c’est de notre survie à tous dont il s’agit. Nous pouvons espérer qu’aucune des générations actuellement présentes sur Terre ne connaîtra l’apocalypse qui semble nous menacer, mais elle concernera certainement nos descendants (directs ou indirects) plus ou moins lointains. Eviter l’extinction prématurée de l’espèce humaine est, comme nous l’avons montré, une nécessité. Cela exige une politique mondiale orientée vers le développement durable, tenant compte des limites de tolérance de la nature.
De même, le fait que la plus grande partie de l’humanité n’a pas le droit de bénéficier de conditions de vie satisfaisantes nous oblige à repenser le système économique de nos sociétés. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’un mode de fonctionnement qui exclut de nombreuses personnes de ses avantages. Nous avons vu en outre que nous ne pouvons pas étendre le système économique actuel à la planète entière, sous peine de voir considérablement se raccourcir l’espérance de vie de l’humanité. C’est ici que se croisent le problème écologique et le problème de l’aide humanitaire et c’est en ce sens que nous pouvons voir dans ce second problème à la fois un argument pour lutter contre l’utopie technologique et le véritable but de l’éthique jonassienne. « Qu’une humanité future soit » est une obligation qui vient limiter l’agir humain. Mais Jonas semble avant tout préoccupé par le problème des trop grandes inégalités et par la mort de millions de gens, essentiellement dans les pays sous-développés. En tout cas, c’est ce que peut nous faire penser la conclusion de l’un des derniers textes qu’il ait rédigé avant sa mort : « C’est un devoir pour la civilisation de combattre la mort prématurée dans l’humanité mondiale et de la combattre en toutes ses causes — faim, maladie, guerre, etc. » (10). Nous pourrions alors pensé que ce devoir doit se traduire par un élargissement de notre système de vie, de notre confort aux pays défavorisés. Mais l’obligation d’exister de l’humanité et le danger que fait peser sur cette dernière notre civilisation technologique nous l’interdisent. Face à cette impossible universalisation de la maxime (technologique) de nos actes, il est alors nécessaire de modifier notre propre façon de vivre afin de pouvoir l’étendre aux pays défavorisés.
Cependant, un abaissement du niveau de vie des sociétés économiquement les plus développées ne créent en aucun cas la destruction des différentes appartenances communautaires. Il est nécessaire que les politiques des différents pays tiennent en considération l’avenir de l’humanité et la situation actuelle des populations des pays les plus démunis mais cela ne revient pas à nier la particularité culturelle des différentes nations. Perdrions-nous donc notre identité en consacrant un peu de notre temps ou un peu de notre argent à des personnes en situation précaire ?
L’argument principal que Walzer oppose à la thèse de l’humanité comme communauté de référence pour l’application de la justice sociale ne nous semble pas recevable. Il est possible de conserver les particularité de chacun tout en permettant à chacun d’avoir droit à la vie humaine et à l’humanité de vivre le plus longtemps possible. Cela permettrait d’ailleurs d’avoir une meilleure économie nationale, car reposant sur une « économie mondiale saine » (11), et d’éviter une montée des violences entre pays, du fait d’une trop grande misère. Car si nous ne faisons pas d’effort, en tant que sociétés au train de vie aisé, pour aider les damnés, qui nous dit que ces derniers ne se révolteront pas, à juste titre, pour obtenir ce dont nous les privons actuellement ?
Plan de l’étude de Hans Jonas * :
- Intro
- I- Les fondements biologiques de l’éthique de la responsabilité
- II- La responsabilité envers les générations futures
- III- Générations futures et populations actuellement damnées
- Conclusion

Hans Jonas : la responsabilité et l’utopie technologique au format PDF « Djaphil
24 avril 2010 à 11:47
[…] A- Les damnés de la terre et l’utopie technologique […]