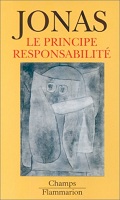 La connaissance scientifique s’inscrit dans l’alternative matérialiste de ce dualisme d’origine cartésienne que nous venons d’esquisser. En un sens, le présupposé à la base, entre autres, de la biologie est que le vivant est uniquement déterminé par des réactions chimiques et des lois physiques. C’est là le principe d’objectivité des sciences de la nature, et ce qui a permis leur essor depuis le XVIIème siècle. Par définition, les sciences modernes recherchent les lois causales qui régissent l’univers. Elles cherchent les causes prochaines qui provoquent les phénomènes qu’elles tentent d’expliquer. Un scientifique « doit croire à la science, c’est-à-dire au déterminisme, aux rapports absolus et nécessaires des choses, aussi bien dans les phénomènes propres aux êtres vivants que dans les autres » (Claude BERNARD, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, librairie Ch. Delagrave, 1900 (2ème édition)). Cette façon de procéder leur permet de les expliquer, mais surtout de les prévoir et de pouvoir intervenir sur la nature, les hommes s’en rendant alors « comme maîtres et possesseurs » (René DESCARTES, Discours de la méthode, 6ème partie. ). N’oublions pas en effet que si la science peut être elle-même un but louable, elle est aussi une recherche orientée par et vers la pratique : elle est une fin en elle-même, mais elle se traduit aussi dans la pratique par des inventions et des découvertes qui visent l’amélioration de notre condition.
La connaissance scientifique s’inscrit dans l’alternative matérialiste de ce dualisme d’origine cartésienne que nous venons d’esquisser. En un sens, le présupposé à la base, entre autres, de la biologie est que le vivant est uniquement déterminé par des réactions chimiques et des lois physiques. C’est là le principe d’objectivité des sciences de la nature, et ce qui a permis leur essor depuis le XVIIème siècle. Par définition, les sciences modernes recherchent les lois causales qui régissent l’univers. Elles cherchent les causes prochaines qui provoquent les phénomènes qu’elles tentent d’expliquer. Un scientifique « doit croire à la science, c’est-à-dire au déterminisme, aux rapports absolus et nécessaires des choses, aussi bien dans les phénomènes propres aux êtres vivants que dans les autres » (Claude BERNARD, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Paris, librairie Ch. Delagrave, 1900 (2ème édition)). Cette façon de procéder leur permet de les expliquer, mais surtout de les prévoir et de pouvoir intervenir sur la nature, les hommes s’en rendant alors « comme maîtres et possesseurs » (René DESCARTES, Discours de la méthode, 6ème partie. ). N’oublions pas en effet que si la science peut être elle-même un but louable, elle est aussi une recherche orientée par et vers la pratique : elle est une fin en elle-même, mais elle se traduit aussi dans la pratique par des inventions et des découvertes qui visent l’amélioration de notre condition.
La biologie ne déroge pas à cela. Outre l’excitation que procure le dévoilement des mécanismes qui sous-tendent notre existence, il y a l’ambition de pouvoir modifier et améliorer ce que la nature nous donne. Derrière la connaissance du génome humain se profilent des retombées pratiques, notamment en ce qui concerne la détection ou même le traitement de maladies génétiques. Il ne faut certes pas confondre les parties théoriques et pratiques, mais elles sont tout de même étroitement liées.
C’est d’ailleurs uniquement cette portée pratique qui fait que les sciences doivent se confronter à l’éthique. Dans le champ théorique, il est impératif que soit conservée une totale liberté d’investigation. La seule contrainte leur est interne : un scientifique doit se plier à une certaine méthode, qui varie selon les disciplines. Il en va tout autrement pour la partie pratique des sciences qui, intervenant dans le monde objectif, n’est pas éthiquement neutre. Toute action, dés lors qu’elle interfère avec le monde humain, ne peut se substituer à la moralité.
Une connaissance scientifique, en soi, n’est ni bonne ni mauvaise, à moins de sous-entendre ici la fin en soi que peut représenter le savoir scientifique, auquel cas elle peut être dite un bien (et non être bonne). Une application pratique, au contraire, peut être jugée bonne ou mauvaise selon deux sens distincts : l’utilité ou bien la valeur morale. Se demander si une invention technoscientifique est bonne ou mauvaise, tel est ce à quoi nous invite Hans Jonas. Mais il élargit le champ de la responsabilité humaine à l’ensemble du monde vivant : nous ne sommes pas seulement responsables de nos actions (technoscientifiques) vis-à-vis de nous-mêmes. La nature elle-même devient objet de responsabilité. « Et si le nouveau type de l’agir humain voulait dire qu’il faut prendre en considération davantage que le seul intérêt de l’homme […] ? » (Hans JONAS, Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, trad. fr. J. Greisch, Paris, Champs Flammarion, 1998., p.34.). Dire, comme le fait Jonas, que la nature elle-même a une sorte de « prétention morale à notre égard » signifie étendre le règne des fins en soi au-delà de la sphère de l’homme.
Or, comme nous l’avons vu, c’est s’opposer au dualisme qui, en fin de compte, sous-tend notre système de connaissance scientifique. La causalité finale ne concerne que l’homme. Pour l’explication de la nature, la causalité efficiente suffit. Si Jonas réhabilite la finalité dans la nature, il se place en opposition avec l’évolutionnisme, qui pour sa part rend compte du vivant par le mécanisme (comme nous l’avons montré précédemment). En outre, il investit un domaine déjà investi par les sciences de la nature : il semble que sa conception soit littéralement en concurrence avec elles, ce qui n’est pas à son avantage. Comme le pense Alex Mauron, Jonas pratiquerait alors « un jeu de langage presque incommensurable au langage de la science », tout en prenant « subrepticement position sur des thèmes qui sont en fait scientifiques » (« Le finalisme de Hans Jonas à la lumière de la biologie contemporaine », in D. MÜLLER et R. SIMON (Ed.), Nature et descendance, Hans Jonas et le principe « Responsabilité », Genève, Labor et Fides, 1993, pp.31-50.). Pour schématiser, Jonas se donnerait la part belle en utilisant une réflexion métaphysique qui ne pourrait en aucun cas être invalidée par la science, et qui lui permettrait de soutenir la thèse inverse de celle de la biologie. En fin de compte, Jonas prendrait position métaphysiquement sur des thèmes qui ne pourraient souffrir qu’une interprétation physique, scientifique, mécanique : la philosophie de Jonas serait alors à ranger dans le rang de l’occultisme.
La thèse que nous voulons défendre est que Jonas, loin de verser dans l’occulte (comme semble le penser le commentateur mentionné précédemment), s’oppose à la totale suffisance du discours scientifique pour épuiser les significations du monde, et notamment celles de la vie. Dés les premières pages du Principe responsabilité, Jonas nous conseille de « rester ouvert à l’idée que les sciences de la nature ne livrent pas toute la vérité au sujet de la nature » (Hans Jonas, Le principe responsabilité…, op. cit., p.35.), la métaphysique permettant alors de suppléer à l’insuffisance des sciences dites dures, « à moins que le rationnel soit déterminé exclusivement d’après les critères de la science positive. » (idem, p.99.).
Mais pour défendre sa position, le philosophe doit d’abord remettre en cause le bien-fondé du dualisme cartésien, qui s’oppose à la possibilité de causes finales en dehors de la sphère de l’esprit. Nous essaierons donc de voir dans quelle mesure il est possible de remettre en cause ce fameux dualisme, historiquement opéré par Descartes, et ce qui pousse Jonas à s’appuyer sur une théorie scientifique qui pourtant se situe dans l’un des deux pôles de cette scission entre res extensa et res cogitans.
Cette distinction entre deux ordres distincts de la réalité (substance étendue / substance pensante) présente un avantage pour la science : elle permet de distinguer un domaine de la réalité qui est entièrement déterminable en terme de grandeur, de figure et de mouvement, d’un autre qui correspond à l’esprit humain. Tandis que le premier peut être traité grâce aux mathématiques, à la physique, à la chimie et, plus tardivement, à la biologie, le second est par excellence le domaine d’investigation réservé aux sciences humaines, notamment à la philosophie. C’est un modèle pratique, qui permet aux sciences de déchiffrer mathématiquement le langage de la nature et de ne s’intéresser qu’à l’éclaircissement des mécanismes à l’ œuvre derrière les phénomènes. Par définition, les sciences modernes s’opposent aux explications finalistes : « La pierre angulaire de la méthode scientifique est le postulat de l’objectivité de la Nature. C’est-à-dire le refus systématique de considérer comme pouvant conduire à une connaissance « vraie » toute interprétation des phénomènes donnée en terme de causes finales, c’est-à-dire de « projet » (Jacques MONOD, Le hasard et la nécessité : essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, Paris, Seuil, 1970, p.34.) ».

Descartes
Comme nous l’avons précédemment évoqué, nous pouvons voir en René Descartes le père de cette méthode scientifique. Ce dernier rompt (même si ce n’est pas encore une rupture totale) avec les explications aristotéliciennes de la nature et les philosophies scolastiques, pour lesquelles, par exemple, le mouvement a pour fin (dans le sens de dessein) le repos. S’opposant aux explications finalistes, Descartes défend au contraire une vision déterministe du monde. « Que chaque partie de la matière, en particulier, continue toujours d’être en un même état, pendant que la rencontre des autres ne la contraint point de le changer. C’est-à-dire que : si elle a quelque grosseur, elle ne deviendra jamais plus petite, sinon que les autres la divisent ; si elle est ronde ou carrée, elle ne changera jamais cette figure sans que les autres l’y contraignent ; si elle est arrêtée en quelque lieu, elle n’en partira jamais que les autres l’en chassent ; et si elle a une fois commencé à se mouvoir, elle continuera toujours avec une égale force jusques à ce que les autres l’arrêtent ou la retardent. » (René DESCARTES, Le monde ou traité de la lumière, chap. VII, in F.ALQUIE (Ed.), Descartes, œuvres philosophiques, vol. I, Paris, Classiques Garnier, 1997, p.351.). A cette première règle déterministe s’ajoute une deuxième concernant la résistance : « quand un corps en pousse un autre, il ne saurait lui donner aucun mouvement, qu’il n’en perde en même temps autant du sien ; ni lui en ôter, que le sien ne s’augmente d’autant. » (idem, p.354.). Ces deux règles unies forment le fameux principe d’inertie. Par l’adoption de ce principe, les causes finales sont évincées du monde physique. Nous entrons alors dans un « nouveau Monde », s’apparentant à un jeu de billard où le mouvement d’une boule trouve son origine dans celui d’une autre boule. Un phénomène donné ne se produit plus en vue de… mais à cause de…
Certes, Descartes pense que derrière les lois de la nature, Dieu agit continûment. Certes il pense que la régularité des phénomènes physiques est la conséquence de l’immuabilité divine : si les lois du mondes sont stables, c’est que Dieu agit toujours de la même manière. Mais c’est cette croyance en une totale régularité de la nature qui est à la base des sciences modernes. Comme le disait l’inventeur de la théorie de la relativité, dieu ne joue pas aux dés. Avec ou sans dieu derrière les phénomènes (ce choix ne relève pas des sciences), ceux-ci sont soumis à des lois stables qui s’expriment en termes de causes et d’effets, sans qu’intervienne une quelconque orientation vers un but : telle est la vision scientifique du monde.
La science explique alors les phénomènes selon un schéma mécanique, en terme de causes prochaines. A partir d’un fait qui se produit, le scientifique cherche la ou les causes suffisantes qui provoquent ce fait. C’est-à-dire que la science se pose la question « comment ? ». C’est à cette question que Darwin tente de répondre quand il invente la théorie de l’évolution. Son problème est de savoir quels sont les mécanismes à l’ œuvre dans la diversification du vivant. Tout comme l’un des problèmes de Newton était, pour schématiser, de découvrir les mécanismes qui font qu’une pomme tombe nécessairement vers le bas.
Cette première question, qui caractérise l’attitude scientifique, se distingue d’une autre question qui agite également l’esprit humain : « pourquoi ? ». Comme nous l’avons vu, c’est une question qui n’est pas du ressort de la science. Selon Claude Bernard, notre esprit s’interroge par nature sur le pourquoi. Mais en cela, « nous visons plus loin que le but qu’il nous est donné d’atteindre ». Ainsi, l’homme se poserait essentiellement une question devant laquelle il ne peut que rester dans l’incertitude, cette interrogation dépassant de loin nos capacités. Ces dernières nous permettent seulement de sonder le comment d’une chose, de remonter aux conditions d’apparition d’un phénomène. L’homme aurait ainsi certaines limites cognitives, qui l’empêcheraient de connaître le pourquoi. « La réalité objective des choses lui seront à jamais cachées, […] il ne peut connaître que des relations. » (Claude BERNARD, op. cit., p.50.), ou encore : « L’homme ne connaîtrait jamais ni les causes premières ni l’essence des choses. Dés lors la vérité n’apparaît jamais en son esprit que sous la forme d’une relation ou d’un rapport absolu et nécessaire. » (idem, p.51.).
C’est grâce à cette croyance au déterminisme et au rejet des causes finales au profit des causes efficientes que les sciences ont connu un tel essor depuis le XVIIème siècle. Mais c’est aussi par les réussites et découvertes ultérieures que le postulat d’objectivité scientifique s’est imposé. Quoi qu’il en soit, « le postulat d’objectivité est consubstantiel à la science » (Jacques MONOD, op. cit., p.38.), c’est lui qui a servi de guide au développement des sciences modernes. Ils sont à tel point liés que l’abandon de ce postulat signifie purement et simplement sortir de la science.
Mais le postulat de l’objectivité découle du dualisme cartésien, instaurant deux ordres hétérogènes dans la nature : l’étendue et la pensée. Lorsque Jonas critique la suffisance des sciences, de l’explication purement mécaniste du monde, à épuiser le sens des choses, il s’attaque d’abord à la légitimité de la distinction cartésienne.
Comme le rappelle Jonas, ce dualisme a pour immense avantage de distinguer les propriétés subjectives des propriétés objectives : le dualisme permet de ne pas confondre ce qui est objectif, appartient en propre à un objet, et ce qui est subjectif mais qu’on a tendance à attribuer à l’objet. Nous retrouvons ici la distinction lockéenne entre qualités premières et qualités secondes. Seules les premières sont inscrites dans la réalité objective. Les qualités secondes, au contraire, sont subjectives. La nette distinction entre ces deux ordres permet aux sciences de la nature de n’avoir a traiter qu’une matière épurée de tout ce qui pourrait relever de l’esprit humain, ce qui leur permet de poser l’objectivité de l’objet qu’elles étudient et de l’expliquer en termes mathématiques et physiques. « L’avantage scientifique du dualisme était, en bref, que le nouvel idéal mathématique de connaissance naturelle était mieux servi par la division claire et nette entre les deux domaines et en fait requérait cette division, qui laissait la science traiter d’une pure res extensa, non infectées par les caractères non mathématiques de l’être. » (Hans JONAS, Le phénomène de la vie, vers une biologie philosophique, trad. fr. D. Lories, Bruxelles, De Boeck Université, collection « Sciences, Ethique, Société », 2000, pp.64-65.)
Ainsi la nature se trouve-t-elle être ontologiquement duelle. L’esprit, d’un côté ; le corps et la matière de l’autre. Descartes ne concède qu’une seule rencontre entre ces deux ordres : il s’agit de l’homme. Si dans les Méditations il met en doute le corps et aboutit à une évidence de la conscience, de l’égo, notre corporéité n’est pas pour autant niée. L’homme est un esprit, mais il a un corps. Cette dualité foncière de l’homme est au c œur de la philosophie cartésienne.
Nous n’entrerons pas ici dans le détail de ce dualisme, dans les mécanismes qui relient l’âme et le corps (tels qu’ils sont exposés par exemple dans Les passions de l’âme), mais il est évident que ce n’est pas sans poser problème. Descartes défend la séparation de l’âme et du corps, tout en défendant leur étroite union. Ce sont deux substances différentes, l’une étendue, l’autre pensante. Pourtant, elles sont unies, dans le sens où le corps tirent certains de ses mouvements de l’âme, et l’âme certaines de ses pensées du corps. Cependant, leur liaison n’est pas de l’ordre de la nécessité : si Dieu ne les unissait pas, les deux pourraient en effet exister séparément. Cette union entre les deux substances est assurée grâce à la glande pinéale et aux esprits animaux. L’hypothèse de la glande pinéale qui assure la liaison de la pensée et du corps est une hypothèse ad hoc que Descartes doit poser pour permettre une interaction entre les deux. Des successeurs comme Spinoza et Malebranche ont recours, quant à eux, respectivement au parallélisme et à l’occasionnalisme : l’union entre l’âme et le corps est à chercher en dernière instance en Dieu. Pour Jonas, le lien problématique entre les deux est l’aveu de la « mortelle faiblesse » de cette vision dualiste du monde. Cette faille réside dans l’absence de causalité entre les deux. Certes l’union cartésienne de l’âme et du corps est substantielle, mais c’est au prix de l’affirmation de la glande comme assurant le passage entre les deux. Du point de vue des sciences de la nature, nier une relation causale entre les deux substances représente cependant un avantage méthodologique, car il permet d’expliquer les différents phénomènes selon le seul mécanisme.
Mais ce dualisme a pour conséquence une séparation radicale de l’homme du reste du vivant. Seul l’homme possède une âme, une intériorité. Les animaux, quant à eux, ne sont que comme des machines, des automates fonctionnant selon les seules lois de la matière. « Leur fonctionnement suggère à l’observateur humain une intériorité analogue à la sienne propre sans qu’ils possèdent une telle intériorité. » (idem, p.66.). En d’autres termes, les animaux ne sont que des corps, totalement privés d’une conscience, même en un sens très restreint. Et si nous leur attribuons pourtant une âme, c’est parce que nous analysons leur comportement, par exemple des expressions (trompeuses) de joie ou de peine, selon les liens causaux qui existent chez l’homme, et uniquement chez lui, entre ses pensées et ses manifestations physiques : c’est faire preuve d’anthropomorphisme. Le dualisme cartésien aboutit donc à une séparation de la conscience, que seul l’homme possède, et du corps, que les animaux et l’homme partagent, les animaux n’étant cependant qu’un corps, même si nous pouvons avoir l’impression qu’ils possèdent une intériorité. L’homme occupe alors une place spéciale, unique dans le règne du vivant : c’est le seul être conscient, c’est le seul a pouvoir se poser des fins et à pouvoir agir selon celles-ci.
C’est cette séparation radicale entre l’homme et les autres organismes vivants que Jonas remet en question. Certes, il ne s’agit pas de remettre en cause les sciences modernes. Jonas est d’ailleurs loin de s’opposer aux sciences. Leurs réussites suffisent à les prémunir de toutes critiques. L’adoption du matérialisme est une position qui, méthodologiquement, est entièrement justifiée. De plus, c’est un modèle qui, s’il ne permet pas de pénétrer la nature ultime des choses, permet au moins de connaître des mécanismes et donc de pouvoir agir sur ceux-ci. Cela, Jonas ne le remet absolument pas en cause. Ce à quoi il s’oppose, c’est à l’élargissement de ce matérialisme au-delà de la simple méthode. Le matérialisme méthodologique est tout à fait acceptable, il a d’ailleurs prouvé, depuis trois siècles, sa fécondité. Mais il n’en va pas de même lorsque ce matérialisme a une prétention ontologique, quand il prétend rendre compte de la réalité.
En effet, cette prise de position ontologique aboutit à un curieux partage de la nature : d’un côté l’homme, qui instaure un nouveau principe, la finalité, au sein de la nature grâce à sa conscience ; de l’autre, le reste de la biosphère, qui lui est entièrement soumis aux lois mécaniques de la nature, sans qu’interviennent une intériorité ou des fins. « Avec le surgissement de la subjectivité au cours de l’évolution, un principe d’action totalement nouveau, hétérogène, entrerait dans la nature, ou bien se manifesterait en elle, et il y aurait une différence radicale (et pas seulement graduelle) — pas seulement entre les créatures, qui participent à ce principe « conscience » (dans ce cas selon des degrés variables), et ceux qui n’y participent pas, mais même chez ceux qui y ont part, entre ce qui est soumis à ce principe (ou ce qui y est soumis avec autre chose) et la partie bien plus large de leur être qui ne lui est pas soumis. » (Hans JONAS, Le principe responsabilité…, op. cit., p.136.). Ce partage aboutirait donc à une double opposition : entre l’homme et les autres vivants, et, en l’homme lui-même, entre ce qui est soumis aux lois de la nature et ce qui relève d’une finalité.
Se pose alors la question de savoir pourquoi et comment Jonas décide de s’appuyer sur l’évolutionnisme pour critiquer cette position alors même que l’on peut considérer que Darwin a ruiné l’explication téléologique du vivant. Ce point d’appui paraît paradoxal. En effet, Jonas s’appuierait sur une théorie qui est matérialiste, s’inscrivant donc dans le dualisme cartésien, alors même qu’il remet en cause le bien-fondé, du moins ontologique, de cette partition.
S’il choisit Darwin comme point de départ, c’est essentiellement parce qu’il considère que la théorie de l’évolution est une sorte d’auto-dépassement du dualisme lui-même. Certes, elle se situe dans l’approche matérialiste du vivant, mais elle impliquerait, en elle-même, la critique du dualisme, dont pourtant elle est issue. Jonas soutient ainsi que l’évolutionnisme s’oppose à la dualité cartésienne, et cela « plus efficacement qu’aucune critique métaphysique n’avait réussi à le faire. » (Hans JONAS, Le phénomène de la vie…, op. cit., p.67.).
Avec Darwin, le matérialisme a connu son plus grand succès. En pénétrant la sphère de l’explication du vivant, le mécanisme a fait les preuves de son extrême fertilité. Mais en même temps, il s’est auto-dépassé, il s’est contredit. Cette contradiction réside dans la nouvelle place désormais attribuée à l’homme. Auparavant, dans la perspective dualiste, l’homme avait une place privilégiée dans le monde : il se distinguait du reste du vivant. Dorénavant, l’homme n’est plus qu’un membre parmi tant d’autres d’une seule et même évolution : tel est l’un des acquis de Darwin. Tous les êtres vivants descendent d’une seule et même origine, et sont soumis à la même sélection naturelle. La théorie de Darwin s’oppose radicalement à la thèse de la place à part qu’occuperait l’homme dans la diversité du vivant, thèse à la base du dualisme cartésien. La continuité caractérise l’évolution du vivant. Cette continuité empêche alors de considérer la conscience et, donc, la finalité apparemment introduite par elle comme représentant un saut par rapport à l’ensemble de l’évolution, « comme l’abrupte intrusion d’un principe ontologiquement étranger en ce point précis du flux total. »(idem.).
Mais que signifie alors, en termes positifs, cette continuité dans l’évolution ? Jonas en conclut qu’il n’est plus possible de refuser la présence de la conscience au reste du monde vivant. Il est arbitraire de réserver l’intériorité aux seuls êtres humains. Contre cette position, Jonas défend au contraire la répartition de l’esprit sur l’ensemble du monde animal. Il ne soutient par pour autant que les animaux possèdent une conscience comparable à celle de l’homme. Mais il pense que l’esprit n’est pas apparu tel quel en l’homme. La conscience n’introduit pas de discontinuité dans l’évolution. Elle est présente chez les animaux, à des degrés divers. Le plus haut degré de conscience se trouve certes chez l’homme, mais le phénomène de la conscience comprise comme intériorité, est présent chez les animaux supérieurs, et disparaît petit à petit, à mesure que nous descendons dans la hiérarchie du vivant.
Il est difficile de s’opposer à cette conception. En effet, les études sur les mammifères supérieurs, tels que certains grands singes, ne montrent-elles pas qu’ils sont doués d’une certaine intériorité ? Les grands singes ont une certaine conscience de leur être. Ceci est appuyé par le fait que certains se reconnaissent lorsqu’ils sont placés devant un miroir. De plus, certains d’entre eux sont capables d’apprendre à communiquer grâce à certains symboles dont ils apprennent la signification. Nous ne voulons pas soutenir que la conscience humaine est comparable à celle d’un orang-outan, mais tout du moins que la dimension intérieure n’est pas un fait uniquement humain, et qu’elle est de moins en moins présente sur l’échelle descendante de la complexité animale.
Mais il reste alors le problème de l’importance de cette intériorité sur l’agir animal. En ce qui concerne l’homme, son appareil digestif fait partie de la classe involontaire des mouvements. C’est de l’ordre de l’instinct. Tout comme le fonctionnement du c œur, ainsi que celui de tous les organes vitaux. Par contre, l’utilisation des ses jambes peut être attribuée, au moins dans certains cas, à la représentation d’une fin. Si nous nous situons dans le dualisme, l’attribution d’un rôle causal à une représentation et l’existence de celle-ci au sein du vivant se limitent au seul cas de l’homme. L’animal non humain, lui, est uniquement déterminé physico-chimiquement. Tous ses comportements sont explicables par des causes mécaniques et nul recours à des buts, conscients ou non, n’est requis : « on dit qu’ici la série entière dans chacune de ses étapes a lieu « instinctivement » suivant une pulsion obscure, c’est-à-dire suivant une contrainte irrésistible qui se manifeste à un moment déterminé et dans des circonstances déterminées, une contrainte qui à proprement parler ne se satisfait qu’elle-même et qui pour autant est aveugle » (Hans JONAS, Le principe responsabilité…, op. cit., p.122.). Il n’y aurait alors ni fins objectives, ni fins subjectives dans l’agir animal.
Jonas, pour sa part, défend l’existence de fins subjectives chez certains animaux, et se positionne contre « le décret de Descartes que la subjectivité comme telle peut seulement être raisonnable et doit donc exister seulement dans l’homme » (idem, pp.127-128.), décret dont, selon Jonas, tous les propriétaires de chien pourront se moquer. C’est en s’appuyant sur le principe de continuité que Jonas défend l’existence, chez les animaux, d’une certaine représentation, d’un degré naturellement moindre que celle dont est capable l’homme.
En effet, Jonas étend le règne des fins à l’être dans sa totalité. La finalité, pour Jonas, n’est pas un phénomène strictement conscient. Ainsi, pour reprendre notre exemple précédent, l’appareil digestif a pour fin la digestion, les organes vitaux ont pour fin, du moins c’en est une, la vie de l’organisme. Ainsi, même les fonctions que nous attribuons à un instinct, à un réflexe, et dont nous pouvons rendre compte par des explications chimiques, sont animées par des fins. Cela irait d’ailleurs, même si ce n’est pas un argument suffisant, dans le sens étymologique de « organe », qui signifie « outil » et présuppose donc une fin. Mais qu’y a-t-il de choquant à dire que si nos organes existent, c’est effectivement pour remplir une certaine fonction ? Jacques Monod défendait déjà, dans Le hasard et la nécessité, la téléonomie du vivant. Ainsi tous les êtres vivants, sans exception, sont-ils des « objets doués d’un projet qu’à la fois ils représentent dans leur structures et accomplissent par leurs performances » (op. cit., p.25.). Pour reprendre un exemple classique, l’ œil a effectivement la vue pour fin. Selon Monod, il est absurde de nier cette téléologie, « arbitraire et stérile de vouloir nier que l’organe naturel, l’ œil, ne représente l’aboutissement d’un « projet » (celui de capter des images) alors qu’il faudrait reconnaître cette origine à l’appareil photographique » (idem.). Certes il n’y a pas de représentation consciente à l’origine de cette téléonomie, tout comme il n’y a pas de projet conscient qui guide l’évolution du vivant dans son ensemble. Mais il est possible de réintroduire le finalisme dans notre compréhension du vivant. Jonas ne défend-il tout simplement pas que la vie est une des fins du vivant et, par là, de la nature dont le vivant est issu, toujours selon le principe de continuité ?
« Avec la production de la vie la nature manifeste au moins une fin déterminée, à savoir la vie elle-même » (Hans JONAS, Le principe responsabilité…, op. cit., p.147.). Ainsi pouvons-nous étendre le règne des fins à l’ensemble de la nature. Non pas des fins subjectives, mais des fins objectives. Si Jonas croit en l’existence d’une « subjectivité sans sujet », à la « dissémination d’une intériorité appétitive germinale à travers d’innombrables particules élémentaire », cette croyance n’est en aucun cas nécessaire pour défendre l’existence d’une finalité objective : « de telles spéculations excèdent de loin ce dont nous avons besoin ici. » (idem.).
Il nous semble qu’il faut distinguer le noyau central de l’argumentation jonassienne de spéculations, non nécessaires pour celle-ci, qui sont peut-être les conséquences de la croyance religieuse de Jonas. Ainsi, lorsque celui-ci pense que la vie était le projet secret de l’être, que l’homme ne pouvait pas ne pas émerger dans la longue évolution du vivant, il s’agit peut-être d’une supposition nécessaire pour un croyant. Mais elle est contredite par nos connaissances scientifiques actuelles. En outre, il nous semble qu’en conservant l’importance du hasard dans notre advenue, et plus originairement dans l’apparition de la vie, nous rendons d’autant plus justice au phénomène de la vie, et cela met d’autant plus en exergue le caractère périssable de la vie humaine et, plus généralement, de la vie : celle-ci est le fruit d’un hasard inouï, d’un miracle peut-être unique, du moins hautement improbable. La mettre en jeu, c’est risquer de la faire disparaître à jamais.
Selon le principe de continuité, l’être, dés le big-bang, renfermait déjà en puissance la vie et la conscience. Mais une infinité de mondes était tout autant en puissance, dont des mondes sans vie ni conscience. S’il est possible et même utile de réintroduire la présence de fins dans le vivant et dans la nature, il ne faut pas voir dans ses fins le résultat d’une représentation consciente. Il faut ainsi accepter d’être enseigné par le supérieur (la conscience) sur l’inférieur, mais sans soutenir que l’inférieur avait pour but nécessaire le supérieur.
La métaphysique de Jonas est donc à comprendre comme complémentaire de l’explication évolutionniste et mécaniste du vivant. Comme le note très justement Paul Ricoeur (Cf. « Ethique et philosophie de la biologie chez Hans Jonas », in Lecture II, Paris, Seuil, 1992.), la philosophie de Jonas est une philosophie de la biologie, c’est-à-dire qu’il fait une interprétation métaphysique de l’explication scientifique de la vie (la théorie de l’évolution). Si les sciences dures, dont la biologie, répondent à la question « comment ? » et se restreignent à l’élucidation des mécanismes qui sont derrières les phénomènes, Jonas interprète ces mécanisme (l’évolution, les mutations génétiques et la sélection naturelle en ce qui concerne la biologie) comme traduisant la présence de fins dans la nature (la nature, au travers de la sélection naturelle, faisant alors preuve d’une capacité de discernement, non consciente, profitant des occasions qui sont favorables à la vie et à la diversification du vivant). En fait, Jonas nous invite à comprendre la nature à partir de la « pointe de l’iceberg » que représente la conscience humaine. La conscience et la finalité consciente disparaissent sûrement à un moment donné, au fur et à mesure que nous pénétrons dans l’iceberg de la vie. Mais il faut comprendre le vivant à partir de son expression la plus achevée, l’homme, « qui parle au nom de l’intérieur muet », il faut considérer l’inférieur à la lumière du supérieur.
Comme pour toute métaphysique, il faut accepter que nous ne pourrons jamais la vérifier comme nous pouvons le faire avec une explication scientifique. Toutefois, cette interprétation a pour avantage, tout en s’appuyant sur Darwin, de ne pas avoir pour présupposé le dualisme cartésien. Le principe d’objectivité ne peut être rejeté, ni même critiqué, du moins quant nous le considérons du point de vue de la méthode. Cependant, ontologiquement, il peut être réfuté.
La métaphysique de Jonas vient ainsi compléter la biologie, en prenant appui sur elle, sans la contredire, cette non-contradiction reposant sur le refus du dualisme d’un point de vue ontologique. Tandis que l’une éclaire les raisons chimiques et physiques du comportement, l’autre interprète ces raisons selon la finalité, en prenant en compte « le témoignage de notre propre être » : « la biologie ne peut, ni se réduire à la physique, ni se passer d’elle » (François JACOB, La logique du vivant, une histoire de l’hérédité, Paris, Gallimard , 1970, p.328.).
Plan de l’étude de Hans Jonas * :
- Intro
- I- Les fondements biologiques de l’éthique de la responsabilité
- II- La responsabilité envers les générations futures
- III- Générations futures et populations actuellement damnées
- Conclusion

sanger
20 avril 2009 à 11:14
la métaphysique , en tant qu’elle pose des questions invérifiables, est une page blanche sur laquelle sont projetées nos obsessions narcissiques, nos peurs, nos espoirs, nos angoisses. J’ai l’impression qu’en grande partie, la métaphysique pourrait constituer un terrain privilégié pour étudier la psychologie , l’anthropologie.
La métaphysique me fait penser à un joueur de loto qui jetterait le billet, à peine acheté: simples pulsions de jeu. Je ne sais pas si on doit parler de passion: il s’agit peut-être de se dissimuler à soi-même que l’on n’est pas passionné et que l’on s’ennuie. Tromper son ennui ainsi; il faut y parvenir !
Pierre
20 avril 2009 à 11:36
On retrouve toutes ces caractéristiques que vous avancez également dans les sciences dites « dures ». Surtout, c’est bien souvent des choix métaphysiques qui sous-tendent les grandes hypothèses scientifiques… à moins de présupposer que la « réalité » existe en tant que telle hors de l’esprit et que nos concepts ne font que refléter cette réalité.